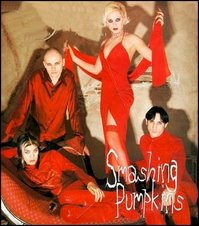A l’heure où le journalisme traditionnel traverse une crise majeure, qui fait augurer à certains noirs prophètes sa disparition prochaine, un nouveau journalisme est en train de naître au pays du Levant, en Corée du Sud. Il s’agit d’un journalisme triomphant, plein de vie et de santé, qui a cette étonnante particularité d’être créé par les citoyens eux-mêmes. Un journalisme citoyen. Zoom sur OhmyNews, poids lourd mondial et leader incontesté de ce journalisme du XXIe siècle.
Oh Yeon Ho n’est pas peu fier de son bébé, le site de journalisme citoyen OhmyNews. Ce dernier aurait réussi, selon son fondateur, à réaliser le fameux «village global» dont parlait Marshall McLuhan, à l’échelle de la Corée du Sud. OhmyNews est né le 22 février 2000 et est aujourd’hui la référence mondiale en matière de journalisme citoyen.
En ouverture de son discours au Congrès de l'Association Mondiale de la Presse, le 31 mai 2004 à Istanbul, en Turquie, Oh Yean Ho n’y est pas allé par quatre chemins pour définir quelle fut l’ambition première de son entreprise : «to say goodbye to 20th century journalism and to create a new 21st century journalism.» Dans la même veine conquérante et triomphante, on peut lire sur son site ce message de bienvenue : «Welcome to the revolution in the culture of news production, distribution, and consumption. Say bye bye to the backwards newspaper culture of the 20th century.»
Tous journalistes
L’idée qui le guide est celle-là même qu’a popularisée le pape du journalisme citoyen, Dan Gillmor, et qu’il a exprimée dans la Bible de tous les citoyens-reporters, son ouvrage We the media : «20th century journalism is one-way. Professional reporters write, and readers read. […] OhmyNews created a two-way journalism. The readers are no longer passive. They can be reporters anytime they want. The main concept of OhmyNews is «Every citizen is a reporter.» Journalists aren't some exotic species, they're everyone who has news stories and shares them with others.»
Ces belles paroles ne sont pas restées lettres mortes depuis la création d’OhmyNews. A l’origine, l’organisation ne comptait que 727 reporters citoyens ; ils étaient, le 31 mai 2004, estimés à 33 000. Et, à la fin du mois de juin 2005, à plus de 38 000 (dont 600 implantés dans le reste du monde). Ces reporters amateurs viennent de toutes les couches de la société sud-coréenne : des étudiants aux enseignants, en passant par les policiers et les militaires. Parmi sa masse immense de contributeurs, OhmyNews compte même ses «stars», des auteurs particulièrement prolifiques et très lus.
L’un d’eux, Lee Bong Ryul, un salarié de 34 ans, a écrit près de 400 articles en quatre ans. Et, en 2002, son audience moyenne par article s’élevait à plus de 10 000 personnes. Quant à Ko Tae Jin, un petit chef d’entreprise de 39 ans, vivant dans une petite ville de la province de Kyungsang, il a écrit des chroniques au rythme soutenu d’une ou deux par semaine, et son audience a dépassé les 20 000 lecteurs.
Fier de ses deux champions, Oh Yeon Ho a déclaré à leur sujet : «I think Mr. Lee and Mr. Ko are the very people we can call journalists. Their performances are equal with professional journalists.» Il n’est plus question ici de préserver soigneusement la différence entre les vrais et les faux journalistes, comme s’y efforcent, par exemple, la plupart des blogueurs influents en France ; on prétend clairement être journaliste, même si ce n’est pas là son métier principal ou officiel.
OhmyNews compte aussi dans ses rangs des journalistes au sens traditionnel du terme, de véritables reporters. En 2004, ils étaient au nombre de 35. Il comporte aussi une équipe éditoriale, qui sélectionne les articles, les accepte ou les refuse, et décide de leur place dans la hiérarchie du site. Selon l’importance qu’elle leur accorde. Des chroniqueurs étrangers de renom viennent enfin étoffer l’immense «rédaction» d’OhmyNews : Terry L. Heaton, David McNeill, John Duerden, Howard Rheingold.
Changer le monde
Les reporters citoyens proposent chaque jour entre 150 et 200 articles, soit plus de 70 % du contenu informationnel du site. Ils sont rémunérés, mais leur cachet reste faible et dépend de la place que les éditeurs auront accordée à leur article : si celui-ci monte dans le «Top News», son auteur sera payé l’équivalent d’environ 17 dollars. La motivation des citoyens reporters est donc autre que l’argent. Selon Oh Yeon Ho, ils écrivent dans l’espoir de changer le monde : «The traditional paper says «I produce, you read » but we say «we produce and we read and we change the world together.»»
Et, de fait, OhmyNews, depuis ses débuts, a sorti des scoops très régulièrement ; en 2002, il a ainsi été le premier média à parler d’un scandale financier qui impliquait le groupe Hyundai. Et Oh Yeon Ho d’ajouter fièrement à ce sujet : «Every mainstream newspaper and broadcaster cited OhmyNews.»
Oh Yeon Ho n’est pas peu fier de son bébé, le site de journalisme citoyen OhmyNews. Ce dernier aurait réussi, selon son fondateur, à réaliser le fameux «village global» dont parlait Marshall McLuhan, à l’échelle de la Corée du Sud. OhmyNews est né le 22 février 2000 et est aujourd’hui la référence mondiale en matière de journalisme citoyen.
En ouverture de son discours au Congrès de l'Association Mondiale de la Presse, le 31 mai 2004 à Istanbul, en Turquie, Oh Yean Ho n’y est pas allé par quatre chemins pour définir quelle fut l’ambition première de son entreprise : «to say goodbye to 20th century journalism and to create a new 21st century journalism.» Dans la même veine conquérante et triomphante, on peut lire sur son site ce message de bienvenue : «Welcome to the revolution in the culture of news production, distribution, and consumption. Say bye bye to the backwards newspaper culture of the 20th century.»
Tous journalistes
L’idée qui le guide est celle-là même qu’a popularisée le pape du journalisme citoyen, Dan Gillmor, et qu’il a exprimée dans la Bible de tous les citoyens-reporters, son ouvrage We the media : «20th century journalism is one-way. Professional reporters write, and readers read. […] OhmyNews created a two-way journalism. The readers are no longer passive. They can be reporters anytime they want. The main concept of OhmyNews is «Every citizen is a reporter.» Journalists aren't some exotic species, they're everyone who has news stories and shares them with others.»
Ces belles paroles ne sont pas restées lettres mortes depuis la création d’OhmyNews. A l’origine, l’organisation ne comptait que 727 reporters citoyens ; ils étaient, le 31 mai 2004, estimés à 33 000. Et, à la fin du mois de juin 2005, à plus de 38 000 (dont 600 implantés dans le reste du monde). Ces reporters amateurs viennent de toutes les couches de la société sud-coréenne : des étudiants aux enseignants, en passant par les policiers et les militaires. Parmi sa masse immense de contributeurs, OhmyNews compte même ses «stars», des auteurs particulièrement prolifiques et très lus.
L’un d’eux, Lee Bong Ryul, un salarié de 34 ans, a écrit près de 400 articles en quatre ans. Et, en 2002, son audience moyenne par article s’élevait à plus de 10 000 personnes. Quant à Ko Tae Jin, un petit chef d’entreprise de 39 ans, vivant dans une petite ville de la province de Kyungsang, il a écrit des chroniques au rythme soutenu d’une ou deux par semaine, et son audience a dépassé les 20 000 lecteurs.
Fier de ses deux champions, Oh Yeon Ho a déclaré à leur sujet : «I think Mr. Lee and Mr. Ko are the very people we can call journalists. Their performances are equal with professional journalists.» Il n’est plus question ici de préserver soigneusement la différence entre les vrais et les faux journalistes, comme s’y efforcent, par exemple, la plupart des blogueurs influents en France ; on prétend clairement être journaliste, même si ce n’est pas là son métier principal ou officiel.
OhmyNews compte aussi dans ses rangs des journalistes au sens traditionnel du terme, de véritables reporters. En 2004, ils étaient au nombre de 35. Il comporte aussi une équipe éditoriale, qui sélectionne les articles, les accepte ou les refuse, et décide de leur place dans la hiérarchie du site. Selon l’importance qu’elle leur accorde. Des chroniqueurs étrangers de renom viennent enfin étoffer l’immense «rédaction» d’OhmyNews : Terry L. Heaton, David McNeill, John Duerden, Howard Rheingold.
Changer le monde
Les reporters citoyens proposent chaque jour entre 150 et 200 articles, soit plus de 70 % du contenu informationnel du site. Ils sont rémunérés, mais leur cachet reste faible et dépend de la place que les éditeurs auront accordée à leur article : si celui-ci monte dans le «Top News», son auteur sera payé l’équivalent d’environ 17 dollars. La motivation des citoyens reporters est donc autre que l’argent. Selon Oh Yeon Ho, ils écrivent dans l’espoir de changer le monde : «The traditional paper says «I produce, you read » but we say «we produce and we read and we change the world together.»»
Et, de fait, OhmyNews, depuis ses débuts, a sorti des scoops très régulièrement ; en 2002, il a ainsi été le premier média à parler d’un scandale financier qui impliquait le groupe Hyundai. Et Oh Yeon Ho d’ajouter fièrement à ce sujet : «Every mainstream newspaper and broadcaster cited OhmyNews.»
L’influence de OhmyNews est véritablement devenue considérable ; l’élection, en 2002, du Président réformateur Roh Moo Hyun lui incomberait pour une part non négligeable. D’ailleurs, c’est à OhmyNews que le Président nouvellement élu a accordé sa toute première interview, au nez et à la barbe des trois grands journaux conservateurs qui dominaient la scène de la presse écrite depuis de nombreuses années. Ce choix du Président coréen se comprend aisément lorsque l’on sait que OhmyNews attire chaque jour des millions de visiteurs, et était devenu, en 2003, le sixième média le plus influent de Corée du Sud (Internet, presse écrite, radios et télévisions confondus).
Plus fondamentalement, OhmyNews est né, selon les dires de son fondateur, d’un désir de démocratie, dans un pays où la presse était, jusque-là, largement aux mains des conservateurs : «Before we started OhmyNews, the Korean media was 80 percent conservative and 20 percent progressive. So I felt that without changing the media market 80-20 imbalance, there would be no democracy in Korea. In that situation, even though there is an important story produced by the progressive media, if the conservative mainstream media ignores it, it cannot become a social agenda. I wanted to equalize it to 50-50. That's why I created OhmyNews with the editorial philosophy of "Open progressivism".»
Made in South Korea
Mais si ce désir a pu se concrétiser et produire des effets aussi rapidement, c’est que la Corée du Sud offrait un terrain particulièrement propice à ce développement. OhmyNews peut être considéré, déclare Oh Yeon Ho, comme : «a special product of Korea.» Des raisons expliquent, selon lui, pourquoi le modèle du reporter citoyen est apparu pour la première fois en Corée du Sud.
Tout d’abord, les lecteurs coréens ont été déçus par les grands médias conservateurs et se trouvaient, pour cela, en attente de médias alternatifs.
Ensuite, Internet est beaucoup mieux implanté en Corée du Sud que dans la plupart des autres pays. Il y connaît un taux de pénétration de plus de 75 %.
Et puis, la Corée du Sud est un pays suffisamment petit pour permettre aux équipes de reporters (reconnus) de relier les lieux où se joue l’actualité en quelques heures, afin de vérifier si l’article d’un citoyen reporter est correct ou non.
Par ailleurs, la Corée du Sud est une société unipolaire, dans le sens où le pays entier peut être appréhendé à travers un nombre limité de questions ; ce qui permet à l’équipe dirigeante de OhmyNews d’adopter une stratégie efficace de «sélection» et de «concentration» : sélectionner les événements les plus importants et concentrer tous ses moyens dessus pour les couvrir aux mieux.
Mais la raison la plus importante à ce succès tient à l’attitude des citoyens sud-coréens elle-même. Ces citoyens étaient prêts à participer à l’aventure. La Corée du Sud peut, en effet, compter sur une génération jeune, active et avide de réformes ; en gros, la génération des gens qui ont entre une vingtaine et une trentaine d’années. D’ailleurs, environ 80 % des citoyens reporters et des lecteurs de OhmyNews appartiennent à cette génération. Ainsi, la technologie seule ne suffit pas ; c’est la disposition de ses utilisateurs, des hommes et des femmes qui se l’approprient, qui est, elle, véritablement décisive.
OhmyNews comporte deux versions : l’une, coréenne, difficilement décryptable pour un Occidental, et l’autre, internationale, rédigée en anglais. Le journal traite une large palette de sujets : affaires coréennes et internationales, technologies, arts, divertissements ; une rubrique est spécialement consacrée aux grandes questions mondiales, et une autre aux interviews. Les articles peuvent être commentés, et il est possible de contacter leurs auteurs. Le site offre enfin un classement hebdomadaire des dix articles les plus consultés.
La révolution de l’information est en marche, et la Corée du Sud présente au reste du monde un modèle à l’avenir probablement prometteur. Les Etats-Unis et la France ont emboîté le pas à la Corée du Sud, avec les créations de deux autres sites de journalisme citoyen : OurMedia et AgoraVox. Gageons que ces précurseurs ne resteront pas seuls longtemps et feront des petits un peu partout sur la planète.
Plus fondamentalement, OhmyNews est né, selon les dires de son fondateur, d’un désir de démocratie, dans un pays où la presse était, jusque-là, largement aux mains des conservateurs : «Before we started OhmyNews, the Korean media was 80 percent conservative and 20 percent progressive. So I felt that without changing the media market 80-20 imbalance, there would be no democracy in Korea. In that situation, even though there is an important story produced by the progressive media, if the conservative mainstream media ignores it, it cannot become a social agenda. I wanted to equalize it to 50-50. That's why I created OhmyNews with the editorial philosophy of "Open progressivism".»
Made in South Korea
Mais si ce désir a pu se concrétiser et produire des effets aussi rapidement, c’est que la Corée du Sud offrait un terrain particulièrement propice à ce développement. OhmyNews peut être considéré, déclare Oh Yeon Ho, comme : «a special product of Korea.» Des raisons expliquent, selon lui, pourquoi le modèle du reporter citoyen est apparu pour la première fois en Corée du Sud.
Tout d’abord, les lecteurs coréens ont été déçus par les grands médias conservateurs et se trouvaient, pour cela, en attente de médias alternatifs.
Ensuite, Internet est beaucoup mieux implanté en Corée du Sud que dans la plupart des autres pays. Il y connaît un taux de pénétration de plus de 75 %.
Et puis, la Corée du Sud est un pays suffisamment petit pour permettre aux équipes de reporters (reconnus) de relier les lieux où se joue l’actualité en quelques heures, afin de vérifier si l’article d’un citoyen reporter est correct ou non.
Par ailleurs, la Corée du Sud est une société unipolaire, dans le sens où le pays entier peut être appréhendé à travers un nombre limité de questions ; ce qui permet à l’équipe dirigeante de OhmyNews d’adopter une stratégie efficace de «sélection» et de «concentration» : sélectionner les événements les plus importants et concentrer tous ses moyens dessus pour les couvrir aux mieux.
Mais la raison la plus importante à ce succès tient à l’attitude des citoyens sud-coréens elle-même. Ces citoyens étaient prêts à participer à l’aventure. La Corée du Sud peut, en effet, compter sur une génération jeune, active et avide de réformes ; en gros, la génération des gens qui ont entre une vingtaine et une trentaine d’années. D’ailleurs, environ 80 % des citoyens reporters et des lecteurs de OhmyNews appartiennent à cette génération. Ainsi, la technologie seule ne suffit pas ; c’est la disposition de ses utilisateurs, des hommes et des femmes qui se l’approprient, qui est, elle, véritablement décisive.
OhmyNews comporte deux versions : l’une, coréenne, difficilement décryptable pour un Occidental, et l’autre, internationale, rédigée en anglais. Le journal traite une large palette de sujets : affaires coréennes et internationales, technologies, arts, divertissements ; une rubrique est spécialement consacrée aux grandes questions mondiales, et une autre aux interviews. Les articles peuvent être commentés, et il est possible de contacter leurs auteurs. Le site offre enfin un classement hebdomadaire des dix articles les plus consultés.
La révolution de l’information est en marche, et la Corée du Sud présente au reste du monde un modèle à l’avenir probablement prometteur. Les Etats-Unis et la France ont emboîté le pas à la Corée du Sud, avec les créations de deux autres sites de journalisme citoyen : OurMedia et AgoraVox. Gageons que ces précurseurs ne resteront pas seuls longtemps et feront des petits un peu partout sur la planète.











 Une star à part. Rocker atypique ce Billy Corgan. Alors qu’en 1995, il a trouvé la recette magique du succès le plus phénoménal avec son double album Mellon Collie and The Infinite Sadness – le double album le mieux vendu de l’histoire de la musique –, il enchaîne en 1998 avec un disque ultra-intimiste, Adore, presque à l’opposé de la grandiloquence mégalomaniaque du précédent, là où tout musicien avide de succès aurait répété jusqu’au dégoût la recette initiale. Adore s’avéra, comme il le dit lui-même, un suicide commercial.
Une star à part. Rocker atypique ce Billy Corgan. Alors qu’en 1995, il a trouvé la recette magique du succès le plus phénoménal avec son double album Mellon Collie and The Infinite Sadness – le double album le mieux vendu de l’histoire de la musique –, il enchaîne en 1998 avec un disque ultra-intimiste, Adore, presque à l’opposé de la grandiloquence mégalomaniaque du précédent, là où tout musicien avide de succès aurait répété jusqu’au dégoût la recette initiale. Adore s’avéra, comme il le dit lui-même, un suicide commercial.