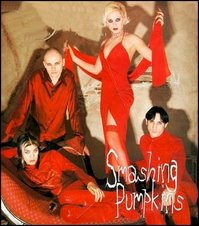26 mai 2007
Revivez l'intégralité du concert des Pumpkins au Grand Rex !
24 mai 2007
Le retour des Smashing Pumpkins
23 mai 2007
Beaux souvenirs de Bercy 2000
Porcelina of the Vast Oceans
Et puis deux petites surprises... venues de 1996...
We Only Come Out at Night
Lily (My One and Only)
22 mai 2007
Les Smashing Pumpkins de retour au Grand Rex
Mardi 22 mai 2007, après presque sept années d'absence, les Smashing Pumpkins effectuent leur grand retour sur scène à Paris, au Grand Rex. Trois heures de concert et de retrouvailles, pour découvrir quelques titres du nouvel album, Zeitgeist, qui sortira le 10 juillet prochain, mais surtout pour réentendre les plus fameux standards du groupe.
19 octobre 2000, à Bercy. Les Smashing Pumpkins - mythique groupe de rock alternatif des années 90 -, sont en pleine tournée d'adieux, et offrent leur dernier concert au public français. Ce soir-là, ils livrent un spectacle grandiose, absolument époustouflant, des sensations d'une intensité inouïe, presque un sentiment d'absolu, qui rend, par la suite, le retour sur terre bien difficile, et fait apparaître, par contraste, la réalité quotidienne incroyablement fade. Le genre d'expérience d'excessive plénitude dont on ne se remet que lentement.
22 mai 2007, au Grand Rex. Le plus grand groupe rock du monde est enfin de retour. La formation a quelque peu changé de visage : elle comprend toujours, bien sûr, Billy Corgan - le charismatique chanteur chauve, guitariste aussi et compositeur -, Jimmy Chamberlin - le batteur d'exception -, mais plus D'arcy Wretzky - la bassiste -, remplacée par Ginger Reyes, ni même James Iha - l'autre guitariste et co-fondateur du groupe avec Corgan -, remplacé, lui, par Jeff Schroeder. Une claviériste, Lisa Harriton, est également de la partie en ce soir de rentrée au Rex.
Sous le signe du classicisme
Vêtus d'un blanc virginal, comme pour signifier leur nouveau départ, les Smashing Pumpkins présentent quelques-uns des titres de leur nouvel album, Zeitgeist (l'on peut reconnaître le single "Tarantula") ; mais ils reprennent surtout les titres qui ont fait leur gloire passée ; il n'en manque pratiquement aucun : "Today", "Hummer" (début et fin), "Rocket", "Cherub Rock", "Silverfuck", "Disarm" (de l'album Siamese Dream), "Bullet With Butterfly Wings", "Thirty-Three", "1979", "Tonight, Tonight", "Zero", "Muzzle" (de Mellon Collie and The Infinite Sadness), "To Sheila", "Shame", "Annie-Dog" (de Adore), "Stand Inside Your Love", "Glass and The Ghost Children" (de Machina/The Machines of God), "Home" (de Machina II/The Friends and Enemies of Modern Music), "Winterlong" (de Judas O), "Untitled" (de Rotten Apples)...
Les nouveaux titres proposés (en l'occurrence, "United States", "Orchid", "Doomsday Clock", "Starz", "Tarantula", "For God and Country", "Never Lost", "That's the Way"), très minoritaires dans la programmation, se trouvent noyés au milieu de tous ces tubes ; d'autant plus qu'ils sont joués en public pour la toute première fois, et ne sont donc absolument pas identifiables par les spectateurs, qui n'en garderont qu'un très incertain souvenir. Les morceaux déjà connus volent inévitablement la vedette aux nouveautés, dont on se sent finalement un peu frustré. Cette forte réappropriation du passé est, certes, sympathique ; mais peut-être aurait-il mieux valu se focaliser davantage sur les dernières créations du groupe.
Globalement, les titres inédits font bonne impression, sans être pour autant transcendants. L'un d'eux m'apparaît, sur le moment, excellent ; mais son souvenir, avec quelques heures de recul, s'évapore déjà... On peut aussi remarquer un très long morceau de près de dix minutes, comme on a coutume d'en trouver un au moins sur chaque album des Pumpkins ; mais son souvenir, à lui aussi, s'est vite envolé...
Au final, était-ce un bon ou un mauvais concert ? Il y eut des hauts et des bas, de belles ascensions prometteuses et quelques creux. Et surtout des moments magnifiques, qui coïncidèrent avec les interprétations de "Thirty-Three", "Cherub Rock" - qui réveilla énergiquement la foule un brin endormie par un "Glass and The Ghost Children" pas trop bienvenu -, "Zero", "Muzzle", mais surtout "Tonight, Tonight", qui fut sans conteste le point culminant de la soirée, soulevant une vague de plaisir et de gratitude dans les gradins pleins du Rex.
Billy Corgan nous aura gratifié de quelques hurlements dont il a le secret, ainsi que d'une petite série de prestations acoustiques, seul en scène. Jimmy Chamberlin aura été, comme à son habitude, monstrueux et fantastique dans son jeu de batteur. Quant aux deux petits nouveaux, ils seront restés plutôt sages et discrets ; on regrette que Corgan n'ait - bizarrement - pas pris la peine de les présenter au public, qui n'aura guère su - sauf les plus initiés - qui étaient ces illustres inconnus durant toute la durée du concert.
Des demi-Pumpkins toujours aussi magiques ?
Au final donc, un bon concert, généreux, de près de trois heures, dont la magie n'aura tout de même pas été équivalente à celle des concerts d'avant la rupture de 2000. Peut-être parce que les Pumpkins, c'était une alchimie unique entre Billy Corgan et Jimmy Chamberlin, certes, mais aussi - presque aussi indispensables - James Iha et D'arcy Wretzky. Les Pumpkins en 2007 ne sont plus que la moitié des Pumpkins d'origine. Il ne faut sans doute pas aller chercher plus loin l'explication de ce défaut relatif de magie.
Le mythe Smashing Pumpkins s'était construit à quatre ; il tenait encore à trois, comme durant la tournée Machina, sans D'arcy, ou la période Adore, où c'est Chamberlin, cette fois-ci, qui avait été mis de côté (suite à ses problèmes de drogue). Mais à deux seulement, le mythe tient-il encore ? Les deux qui restent ont, certes, toujours constitué la colonne vertébrale du groupe ; ce sont sans doute ses deux pièces maîtresses. La colonne suffit bien à faire un très bon groupe de rock ; mais elle ne suffit peut-être pas pour conserver le génie créatif à son plus haut niveau.
Attendons tout de même Zeitgeist, attendons de l'écouter en intégralité, et de le réécouter - car les chansons des Pumpkins ne se donnent que rarement à la toute première écoute -, ruminons-les un peu, et alors seulement nous saurons... si le génie est encore là, intact, miraculeusement sauvé de la scission, ou s'il s'est dissipé tristement. Le beau concert de ce soir ne permet pas de trancher. Il aura seulement confirmé, s'il en était besoin, que les Smashing Pumpkins sont un vrai groupe de scène, à la puissance et à la force de conviction inégalées.
Il semblerait, enfin, que Zeitgeist soit un album engagé. Sa pochette, en tout cas, le laisse penser : elle représente, en effet, la Statue de la Liberté en train de se noyer. Son créateur, Shepard Fairey, dit avoir puisé son inspiration dans le réchauffement climatique, en lequel il voit le symbole d'un certain aveuglement américain. Mais la Statue de la Liberté sert aussi de métaphore pour illustrer la menace qui pèse sur certains idéaux fondateurs de la société américaine, comme les libertés civiles, la liberté d'expression, ou le droit à la vie privée. Autant d'acquis en péril depuis les attentats du 11 septembre et la réaction de l'administration Bush. Le soleil, derrière la statue, symbolise, quant à lui, l'espoir. Reste à savoir s'il se couche ou se lève... Ce mouvement dépend sans doute de la volonté humaine... En tout cas, nul doute que Corgan et ses Citrouilles Eclatées ne destinent pas le soleil à se coucher dans la mer.
21 mai 2007
En avant-première : Tarantula !
A la veille du retour sur scène des Smashing Pumpkins au Grand Rex à Paris, voici en (presque) exclusivité mondiale le premier single de leur nouvel album Zeitgeist : "Tarantula". Ne nous voilons pas la face : ce tout premier morceau n'est pas à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre. Assez fortement imbibé de l'esprit de Zwan et de Mary Star Of The Sea, qui, à l'époque (en 2003), n'avait pas franchement séduit les fans des Pumpkins. On attend donc la suite... en espérant qu'elle sera d'un tout autre niveau. Mais ce "Tarantula" ne constitue pas le meilleur des présages. Le plaisir n'est, certes, pas complètement absent, mais bien faiblard tout de même.
16 mai 2007
Faim dans le monde : une insurrection morale est-elle encore possible ?
La faute à qui ? Au monde tel qu'il va. Et tel qu'il continuera vraisemblablement d'aller. La faute, selon Ziegler, aux "500 multinationales qui contrôlent 52 % du PIB mondial", "ne s'intéressent absolument pas au sort des pays dans lesquels elles sont implantées", "mènent une politique de maximalisation des profits et assoient leur pouvoir par la corruption des dirigeants". Et ce, dans un monde où "la normativité, qui était ancrée dans la souveraineté des Etats nationaux, se défait comme un bonhomme de neige au printemps" (toujours selon Ziegler, lors de son passage dans l'émission de France 2, Des mots de minuit).
Petit tour du monde de l'absurde
Quelques illustrations de ce monde qui ne tourne pas rond ? A Vienne, en Autriche, on jette environ 2 millions de kilos de pain par an, pourtant parfaitement comestibles. La quantité de pain ainsi gaspillée chaque jour pourrait nourrir la deuxième ville du pays, Graz.
En Roumanie, deuxième producteur agricole européen derrière la France, le leader mondial des ventes de semences, Pioneer, impose ses OGM, ses semences à utilisation unique, et détruit progressivement les modes de culture traditionnels. Un représentant du groupe nous livre un témoignage étonnant, précise-t-il, en son nom propre : il annonce, en effet, l'inéluctable hégémonie future des OGM, tout en la regrettant, souhaite que l'agriculture ancienne puisse résister, alors même qu'il participe activement à la liquider. Illustration, sans doute, du conflit interne à chaque homme, entre son intérêt et sa conscience...
Cet homme, courgettes en main, fait remarquer que celles qui sont génétiquement modifiées sont, certes, bien plus agréables à regarder, plus grosses, plus séduisantes pour le consommateur... mais n'ont aucun goût ; en tout cas, bien moins que les courgettes classiques, plus petites, plus tordues, et moins affriolantes à la vue. Désabusé, il prédit que, demain, les enfants ne connaîtront plus le goût d'une pomme ou d'une tomate authentiques. Le goût n'est malheureusement pas un critère retenu par les multinationales de l'agro-alimentaire. Le critère unique, c'est le profit, et sa maximalisation. Et puis, fait-il finalement remarquer : veut-on de bons produits en faible quantité, ou de mauvais qui pourront nourrir tout le monde ?
Passons, à présent, l'Atlantique. Depuis 1975, les paysans brésiliens ont défriché la forêt vierge et ses arbres gigantesques, qu'on avait coutume de qualifier de "poumons de la Terre", sur une surface équivalant à la France et au Portugal réunies, pour y cultiver du soja, au point que le Brésil en est devenu le premier producteur mondial. Or, le soja appauvrit la terre amazonienne. Un soja qui est ensuite exporté massivement vers l'Europe, où il sert à nourrir... les cheptels, et, en particulier, les poulets. Pendant ce temps-là, les paysans souffrent de malnutrition chronique (comme 25 % des Brésiliens), et vivent dans une telle misère qu'ils doivent puiser leur eau - à boire - dans des mares polluées, à leurs risques et périls.
Situation tout aussi absurde au Sénégal, où les paysans voient affluer sur leurs marchés, au tiers du prix local, les légumes et fruits européens subventionnés, qui les condamnent à ne pas pouvoir vivre de leurs propres productions. Du coup, certains d'entre eux, sans espoir de survie chez eux, malgré leurs journées de travail de 18 heures, émigrent illégalement vers l'Europe, pour s'y faire exploiter (et servir, à l'occasion, de boucs émissaires). A ce drame, Ziegler apporte ce début de réponse : "Pour créer les conditions d’un développement autonome de l’Afrique, l’Europe devrait commencer par supprimer les 349 milliards de dollars de subvention à l’exportation de ses produits agricoles. Le poids de la dette est un garrot qui bloque tous les investissements productifs. L’Europe devrait forcer les grandes banques à accepter sa suppression."
Les poulets et le PDG
Les films d'horreur mettent parfois du temps à faire peur ; il nous font patienter longuement avant de nous faire sombrer dans la franche épouvante. We Feed The World ne déroge pas à la règle. L'ensemble du film est inquiétant ; les deux dernières séquences, elles, glacent littéralement le sang.
D'abord, nous nous retrouvons dans une usine autrichienne qui fabrique des poulets, comme on fabriquerait des jouets ou des voitures. Une usine à bouffe, où l'animal en tant que tel n'existe plus. Fini l'animal qui a sa vie propre, et qu'un jour on chassera et tuera pour le manger. L'animal est ici nié dans son être, et d'emblée réduit à de la bouffe.
Tout commence dans des poulaillers géants, contenant jusqu'à 70 000 individus. Là, dans ces hangars sordides, poules et coqs se reproduisent. Les oeufs pondus sont placés dans des incubateurs. Puis dans de grandes caisses. Les poussins y éclosent, comprimés les uns contre les autres. Ensuite, comme n'importe quels objets dans une usine à la chaîne, ils suivent, sur des tapis roulants qui vont à toute vitesse, un parcours automatisé, durant lequel ils se font bringuebaler dans tous les sens. Ils atterrissent dans d'impressionnants hangars, où ils vont être gavés. A peine le temps de grandir qu'ils sont transportés à l'abattoir. Sans avoir jamais vu la lumière du jour. Sans avoir jamais gambadé en pleine nature. Sans avoir jamais "vécu". Passons sur l'abattage lui-même, nouveau parcours à la chaîne sur tapis roulant, avec électrocution via passage de la tête dans un bassin liquide, et décapitation, jusqu'à l'arrivée finale du cadavre sous cellophane. Prêt à déguster. Ces images soulèvent le cœur et donneront, à n'en pas douter, quelques scrupules aux futurs consommateurs que nous sommes, lorsque nous nous retrouverons face à face avec un poulet sous cellophane au supermarché.
Là encore, il est surprenant d'entendre un acteur de ce système, qui travaille dans une de ces usines à poulets, tenir des propos très critiques à l'encontre de sa propre activité : "Le consommateur ne sait plus comment le système fonctionne. [...] Les gens deviennent indifférents et brutaux pour arriver à leurs fins. Pourquoi ? Car dans les hautes sphères, il n'y a plus personne qui a commencé en bas de l'échelle. [...] Tous ces gens qui étudient à l'école et quittent l'université avec une licence ou un doctorat n'ont plus aucun lien avec leurs racines. Ils voient l'agriculture comme la plupart des gens, à savoir comme on la présente dans les pubs, idéalisée. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Le marché ne s'intéresse qu'au prix. Le goût n'est pas un critère." La sale besogne est laissée à quelques professionnels qui ont presque honte de ce qu'ils font, tandis que les consommateurs, et peut-être même les maîtres du système, ignorent tout des pratiques de terrain qui permettent la réalisation du profit et sa maximalisation tant recherchée et vénérée.
Ultime scène d'horreur du documentaire de Erwin Wagenhofer : la visite au PDG de Nestlé, Peter Brabeck. Celui qui dirige la plus importante multinationale alimentaire mondiale - et qui n'a pas dû voir le film qui précède son entrée en scène - nous assure que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, que le monde n'a jamais été aussi riche, que chacun peut aujourd'hui avoir tout ce qu'il veut... Il nous assure que l'avenir appartient aux OGM, que le bio, ce n'est pas si bien que cela... Il se réjouit de ce que l'homme ait enfin réussi à vaincre la nature hostile, à la maîtriser, à la manipuler à sa guise, et nous promet que tout cela est sans danger ; preuve en est, les OGM n'ont, à ce jour, causé aucune maladie chez nos amis américains. Il s'étonne donc candidement de ce que certains affichent quelques états d'âme vis-à-vis des manières de faire des grandes entreprises transcontinentales qui dirigent le monde.
Mais ce n'est pas tout. Voici venue l'heure du grand frisson... Peter Brabeck s'interroge très sérieusement sur le prétendu droit de tous les hommes à bénéficier de l'eau ! Ce cher monsieur, bronzé aux U.V. (comme le souligne malicieusement Ziegler), qualifie d'extrémistes les ONG qui considèrent que chaque homme de ce monde a droit à l'eau, et se prononce, pour sa part, en faveur de la privatisation de cette dernière, en laquelle il voit une denrée alimentaire comme une autre, qui a donc une valeur marchande, un prix, et que seuls ceux qui pourront se la payer auront le droit de consommer. Pour les autres... Faudra s'adapter, j'imagine, être flexible... moderne...
En résistance contre la privatisation du monde
Jean Ziegler, dans un entretien au quotidien suisse Le Courrier du 24 octobre 2002, avait déjà pointé "la visée historique de cette oligarchie transcontinentale", incarnée par le PDG de Nestlé : il s'agissait de "la privatisation du monde". En effet, nous disait-il, "pour les maîtres du monde, il ne saurait exister de «biens publics». Cette visée est contenue dans le Consensus de Washington, un ensemble d'accords informels liant les principales sociétés transcontinentales, les banques de Wall Street, la Federal Reserve, la Banque mondiale, le FMI, l'OMC. Le but de cette alliance est l'instauration d'une stateless global governance, d'un marché mondial unifié et totalement autorégulé. Leur méthode : l'élimination de l'Etat et de toute instance régulatrice."
Alors que l'Europe affiche, disait-il en 2002, "une indigne soumission à l'empire états-unien", alors même qu'elle "a les moyens de résister", Ziegler situe le dernier rempart contre la privatisation du monde dans "la Charte des Nations Unies et la Déclaration des droits de l`homme". "Les valeurs qu'elles contiennent et véhiculent", poursuit-il, "constituent la norme ultime de toute politique. Les nouvelles formes d`organisation issues de la société civile se meuvent dans cette constellation de valeurs. L'espoir vient de ces réseaux qui associent des individus et des groupes de manière transversale sans hiérarchie, sans dogmatisme, sans programme commun. Ils sont absolument et totalement dans la résistance. Contre la privatisation du monde. Georges Bernanos a écrit : «Dieu n`a d`autres mains que les nôtres.» Nous vivons en démocratie, nous pouvons et devons renverser l'ordre meurtrier du monde."
Réentendre la voix oubliée des sages
En voyant We Feed The World, j'ai pensé, par contraste, à deux êtres extraordinaires, dont les paroles précieuses nous manquent : l'ethnologue Claude Lévi-Strauss et le romancier Jean-Marie Gustave Le Clézio. Ces deux sages ont toujours été fascinés par des peuples (amérindiens entre autres) qui savaient vivre dans une "bonne entente avec la nature" (11e minute de cet entretien entre les deux hommes), en harmonie avec elle - du fait de leurs croyances : "Quand il existe des croyances en un maître des animaux, qui veille jalousement sur les procédés de chasse, et dont on sait qu'il enverra des châtiments surnaturels à celui ou à ceux qui tueraient plus qu'il n'est strictement nécessaire, quand, pour cueillir la moindre plante médicinale, il est nécessaire de faire d'abord des offrandes à l'esprit de cette plante, tout cela oblige à entretenir avec la nature des rapports mesurés. Et certains peuples ont même cette croyance que le capital de vie qui est à la disposition des êtres fait une masse, et que, par conséquent, chaque fois qu'on en prend trop dans une espèce, on doit le payer aux dépens de la sienne propre..." (voir ce bel entretien entre Bernard Pivot et Lévi-Strauss à partir de la 27e minute).
Des peuples qui développaient, continue Lévi-Strauss, "une façon sensée pour l'homme de vivre et de se conduire, et de se considérer, non pas, comme nous l'avons fait, [...] comme les seigneurs et les maîtres de la création, mais comme une partie de cette création, que nous devons respecter, puisque ce que nous détruisons ne sera jamais remplacé, et que nous devons transmettre telle que nous l'avons reçue à nos descendants. Ça, c'est une grande leçon, et presque la plus grande leçon que l'ethnologue peut tirer de son métier." Une leçon à inculquer d’urgence à Peter Brabeck.
Le Clézio aussi nous parle de peuples qui ne partagent guère notre civilisation technique du rendement, et qui ont un sentiment de "la très grande fragilité" de la nature, qui savent par exemple que l'excès d'exploitation est néfaste, que si l'on remplace la forêt naturelle par des champs en monoculture, l'on obtient une détérioration du sol (écouter cet entretien vers 30min40). Il nous entretient de ces peuples qui vivent dans le respect des plantes, ne les cueillent qu'avec une extrême précaution, et si seulement elles ne sont pas trop jeunes, tout comme ils ne pêchent point de poissons qui n'auraient suffisamment vécu, ces peuples qui placent plantes et animaux à égalité avec les hommes. On est loin des poulets d'usine tenus toute la durée de leur courte vie à l'abri de la lumière du soleil, et traités non comme des être vivants, mais comme des objets utilitaires à l'homme. On est loin du massacre de la forêt amazonienne, remplacée par des champs de soja à perte de vue, destinés au gavage des poulets d'usine... On est loin de cette culture mortifère décrite par We Feed The World.
La nostalgie d'un Lévi-Strauss ou d'un Le Clézio pour ces peuples que d'aucuns qualifiaient de "sauvages", de "barbares", ou de "primitifs", peut être salutaire. Car c'est bien de l'esprit écologique (certes laïcisé) qui les animait que viendra, s'il doit venir, le salut de notre civilisation.
11 mai 2007
Sarkozy, ou le triomphe des passions tristes
Nicolas Sarkozy est élu président de la République depuis maintenant cinq jours. Parmi les premières réactions, on aura pu noter celle, réjouie, du Medef, qui promet de "contribuer avec enthousiasme à l'écriture de la nouvelle page qui s'ouvre pour la France", ou encore celle, plus inattendue, du leader d'extrême droite autrichien Jörg Haider, qui considère que le nouveau président français s'inspire de son "modèle" : "C'est une ironie de l'histoire que les Français élisent maintenant leur Jörg Haider, et une satisfaction que le "Napoléon de poche" Jacques Chirac appartienne désormais au passé." Quant à la secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice, elle estime que l'élection de Nicolas Sarkozy ouvre "une période excitante pour la France". Condy ne s'y trompe pas, puisque 730 voitures ont brûlé dans le pays dès la nuit de son élection, et que de nombreuses manifestations hostiles ont pris le relai un peu partout sur le territoire depuis.
Pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy a pu commencer à mettre en pratique sa conception très "à l'américaine" de la présidence, et son idée - si chère à son coeur - selon laquelle les riches ne doivent plus avoir honte d'exhiber les fruits de leur réussite bien méritée, en s'offrant une petite croisière bien sympathique à Malte, à bord du superbe yacht de son ami, le milliardaire Vincent Bolloré, un yacht répondant au doux nom de Paloma, long de 60 mètres, avec jacuzzi sur le pont supérieur, que vous pourrez vous aussi, si le coeur vous en dit, louer pour quelques 193 431 euros la semaine pour vos prochaines escapades de winner... lorsque vous aurez eu la satisfaction préalable de travailler plus pour gagner plus. T'as trop raison Nico, quel intérêt d'avoir du temps libre quand on n'a pas de quoi payer à sa famille de vraies vacances dignes de ce nom ?
La France en mille morceaux
Prenons donc exemple sur les plus méritants des Français, les Neuilléens : "Les gens qui habitent Neuilly sont ceux qui se sont battus pour prendre plus de responsabilités, pour travailler plus que les autres" (Marianne, 14 au 20 avril 2007). Quelle belle parole Nicolas ! Gloire aux travailleurs de Neuilly ! Et honte aux "autres" (bande de fainiasses...) ! Telle est bien la France de Nicolas Sarkozy : une France clivée, divisée, entre battants et fainéants, bons travailleurs corvéables à merci et assistés misérables sur lesquels on peste avec rage, honnêtes gens revanchards qui ne jurent que par le triptyque "Travail-Famille-Patrie" et dégénérés de soixante-huitards avec lesquels il faut en finir au plus vite, braves gens qui rasent les murs dans les cités et racailles à nettoyer d'urgence au Kärcher, Français-qui-se-lèvent-tôt-le-matin et Français-génétiquement-mal-barrés...
Nicolas Sarkozy veut être le président de tous les Français, c'est en effet la moindre des choses... Mais il n'a cessé, durant sa campagne, de dresser des Français contre d'autres Français, il a attisé les haines, les jalousies, les ressentiments de tous contre tous. Nombre de ses électeurs ont voulu porter au sommet de l'Etat un Père Fouettard, un homme qui leur promettait de punir certaines catégories de la population trop favorisées ou trop câlinées (à leur goût) jusqu'à maintenant. Ce sera dur de rallier ceux qu'on a traités - à des fins électoralistes - comme des ennemis.
Spinoza n'aurait pas voté Sarkozy
Nicolas Sarkozy a usé de la méthode la plus efficace qui soit pour accéder au pouvoir (et pour l'exercer ensuite). Il a joué sur nos "passions tristes" : "Inspirer des passions tristes est nécessaire à l'exercice du pouvoir", enseignait Gilles Deleuze dans un cours sur Spinoza prononcé à Vincennes le 24 janvier 1978. "Et Spinoza dit, dans le Traité théologico-politique, que c'est cela le lien profond entre le despote et le prêtre, ils ont besoin de la tristesse de leurs sujets. Là, vous comprenez bien qu'il ne prend pas tristesse dans un sens vague, il prend tristesse au sens rigoureux qu'il a su lui donner : la tristesse c'est l'affect en tant qu'il enveloppe la diminution de la puissance d'agir".
Parmi ces passions tristes, la haine, l'envie, la jalousie, la colère, la vengeance furent particulièrement mises à profit par l'ancien ministre de l'Intérieur. Les boucs émissaires qu'il nous a trouvés ? Les "autres", c'est-à-dire : les assistés, les fonctionnaires (ces privilégiés...), les syndicalistes, les fraudeurs, les voyous, les racailles, "ceux qui profitent du système", "ceux qui demandent toujours et qui ne veulent jamais rien donner", et puis les égorgeurs de moutons, les soixante-huitards, les adeptes de la repentance, les élites de gauche - toujours du côté des délinquants et des assassins, jamais de celui des honnêtes gens, n'est-ce pas ? -, les juges trop laxistes de Bobigny, les policiers qui jouent au rugby avec les jeunes au lieu de les mettre en prison (revoyez cette séquence : quelle humiliation pour les policiers, quel sadisme de notre gendarme à Saint-Tropez !), et même les politiques et les technocrates (voyez ce morceau nauséeux du discours de Bercy), et j'en oublie sûrement.
Le (dé)goût des "autres"
Nicolas Sarkozy s'est voulu le candidat de "la France qui paie toujours pour tous les autres", "la France qui paie les conséquences de fautes qui ont été commises par d'autres"... les fameux "autres" dont nous venons de dresser une petite liste non exhaustive, et sur la haine desquels Sarkozy a construit sa victoire, en remuant les passions tristes de ses supporters... Cette méthode très efficace à court terme est néanmoins désastreuse sur le long terme : elle crée un climat malsain entre les gens, et ruine le peu d'unité qui peut exister entre membres d'une même nation. Les passions tristes parvenues au pouvoir sont, en quelque sorte, légitimées, elles n'ont plus à se cacher, à se modérer, à s'amender pour se renverser en passions joyeuses, qui, elles, unifient sainement le corps social.
On pourrait croire à une exception dans cet usage des passions tristes, lorsque Nicolas Sarkozy marque son rejet de la repentance, ce regard critique qu'un peuple porte sur son passé, et qu'il identifie à une "détestation de la France et de son Histoire". Mais, en fait, non ; car la réhabilitation du pays se fait, chez lui, par la stigmatisation des repentants, la dénonciation d'autres coupables (irrépressible manie de se défausser en désignant dans le même mouvement un bouc émissaire), et passe finalement par une exaltation presque délirante de la fierté d'être Français. Sarkozy réinvente ainsi une histoire exclusivement glorieuse de la France, qui "n'a pas commis de crime contre l'humanité", "n'a jamais commis de génocide", "n'a pas inventé la solution finale" (petite douceur adressée à nos amis allemands...), mais "a inventé les droits de l'homme" ; et mieux encore, "la France est le pays du monde qui s'est le plus battu dans l'univers au service de la liberté des autres" ("dans l'univers" !). Oublié le régime collaborationniste de Vichy. Oubliés le Code noir et l'esclavagisme. Oubliée la colonisation. Entre la flagellation perpétuelle et l'oubli, il y a une marge évidemment, et une juste attitude à trouver, mais Nicolas Sarkozy ne fait pas dans la nuance ; il réécrit l'histoire au Kärcher, pour flatter la fibre la plus nationaliste d'un électorat en mal de grandeur mythifiée.
Singer le grand loup blanc
Le nouveau chef de l'Etat français partage ce dégoût pour la repentance avec celui qui lui aura servi de principal modèle durant toute sa campagne présidentielle : Jean-Marie Le Pen.
La campagne de Nicolas Sarkozy démarre, en effet, le 21 avril 2002. La démangeaison extrémiste est là en France, et Sarko la sent... comme un loup affamé flaire sa future proie aux quelques gouttes de sang qui perlent de ses blessures. Le Pen, en fin tacticien, en vieux loup de la politique, a depuis longtemps flairé les thèmes porteurs, ceux qui rencontrent le plus fort écho dans le peuple, le "petit peuple" si souvent méprisé et tellement courtisé à la fois. Il a compris que le moyen le plus simple de fédérer un grand nombre de sympathisants autour de soi, c'est de leur faire peur et de désigner des boucs émissaires, en promettant de "punir" ces derniers. Avec lui, le bouc émissaire était unique, c'était l'immigré, ou, dans un langage plus convenu, "la politique d'immigraton des gouvernements successifs de gauche comme de droite". Sarkozy a repris à son compte la tactique lepéniste, mais en démultipliant les boucs émissaires, en divisant le pays à outrance.
Moi je dis les choses comme je pense
Le mimétisme avec Jean-Marie Le Pen se poursuit dans l'attitude de pourfendeur de tabous que Nicolas Sarkozy a, lui aussi, décidé de faire sienne. Le Pen disait : "Moi je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas." Sarkozy ne cesse d'user de cette formule : "Moi je dis les choses comme je pense", en ayant bien pris soin, au préalable, de dire que, dans ce pays, "on ne peut plus rien dire sur rien". Son discours laisse constamment entendre que nous vivons sous le règne de la pensée unique, d'une quasi censure (instaurée par qui ?), et que lui seul vient parler vrai au milieu d'un discours trop policé et convenu. Lui, au moins, il parle franchement. Il n'hésite pas. Il n'a pas peur. Il ose ! Et puis, il parle comme les gens, les "vrais gens", ceux qu'il a découverts durant sa campagne : "Pendant des mois j’ai vu ce que le peuple vivait, ce qu’il ressentait, ce qu’il souffrait". Il a vu les Français, ceux d'en-bas, les vrais, les authentiques. Et il a compris que parler comme eux, ça pouvait rapporter gros : "Vous savez pourquoi je suis tellement populaire ? Parce que je parle comme les gens" (déclaration d'avril 2004, reprise dans Marianne). Alors il parle de "racailles", car dans les banlieues, les gens ils parlent comme ça, les jeunes ils se parlent comme ça. Y a pas à être choqué ! Les Français veulent que leurs représentants politiques leur ressemblent, soient, le cas échéant, aussi vulgaires qu'eux. Pas de chichi ! Sarkozy exauce ce voeu.
Les gens qui apprécient ces manières de faire se trompent, car évidemment l'authenticité est feinte, calculée, méprisante - et méprisable. Et puis, surtout, dire tout haut ce qu'on pense tout bas, cela n'est pas penser : "Bien penser, cela ne va pas de soi. [...] Si vous vous laissez aller, vous êtes pris par quelque chose qui n'est pas vous [...]. La nature mécanique nous guette toujours et nous tient toujours. [...] On pense faux comme on chante faux, par ne point se gouverner. [...] Bien penser est une chose que l'on se doit à soi-même, et qu'il faut vouloir. Ainsi l'homme n'est pas un spectacle permis à lui-même ; ni permis, ni possible". C'est toute la sagesse du philosophe Alain dans ses Propos, et notamment celui-ci, "Régler ses pensées", du 7 août 1929. Penser, c'est corriger ce qu'on pense, redresser constamment ses pensées, qui, sans cet effort, deviennent animales, et proprement étrangères à nous-mêmes - indignes de l'Homme.
Sarkozy, qui assimile la liberté à la transgression, ne se prive pas pour transgresser les odieux carcans de la pensée unique. Il lance ainsi des débats scientifiques, en toute liberté, sur le déterminisme génétique par exemple, il donne son avis à lui, sans prendre la peine de s'en référer aux autorités compétentes. Et sur quoi fonde-t-il ses convictions ? Sur sa propre expérience : "Moi j'ai jamais eu la pulsion d'aller violer un enfant de trois ans, j'en ai aucun mérite, et je ne pense pas que c'est mon éducation qui m'ait porté à ne pas avoir eu cette pulsion..." Ou encore : "Je ne me souviens pas moi, quand j'avais 14 ou 15 ans, d'avoir réfléchi à mon identité sexuelle, je suis hétérosexuel... Je ne me suis pas longuement interrogé pour savoir si j'aimais les hommes ou les femmes..." Ajoutant, au passage, que la campagne présidentielle est "un grand moment de sectarisme" (toujours cette foutue censure... à laquelle lui seul échappe). Alors, certes, Sarkozy ne prétend pas trancher les questions de manière définitive, l'infaillibilité papale ne fait pas encore partie de ses prérogatives. Mais il ose tout de même donner ses vérités scientifiques à lui. Un peu comme Le Pen lançait, lui aussi, des "débats", sur l'existence et l'inégalité des "races", contre l'avis de tous les scientifiques. Et lui aussi fondait ses convictions sur l'évidence ("Il y a des Noirs, il y a des Jaunes..."), le bon sens populaire, n'omettant pas de dénoncer "l'inhibition sémantique" des frileux...
N'ayez pas peur ! J'arrive...
Avec Le Pen, on était aussi habitué à l'exploitation éhontée des faits divers les plus sordides, des crimes les plus atroces, que le brillant tribun s'évertuait à narrer dans le détail jusqu'à faire frémir son auditoire, lors de dîners dont il s'était fait une spécialité, et qui lui permettait de conclure, solennellement, à la nécessité du retour de la peine de mort. Sarkozy a su, lui aussi, instrumentaliser les pires crimes de sang, sans une once de pudeur, pour justifier sa politique répressive (qu'il n'a pourtant pas su mettre en oeuvre durant ses nombreuses années passées place Beauvau), ou, du moins, pour se donner l'image du chef autoritaire et impitoyable qu'appelle de ses voeux le vengeur masqué qui sommeille en chacun d'entre nous, dès lors qu'il est confronté à l'horreur, à l'innommable barbarie qui fauche les vies innocentes.
Morceaux choisis du discours de Bercy : "Je suis allé à la rencontre des Français [...] avec en moi le souvenir de cette famille à la Courneuve qui pleurait la mort d'un petit garçon de onze ans. C'était le jour de la fête des pères, deux bandes rivales s'affrontaient au pied de l'immeuble, il a pris une balle perdue. C'était le jour où j'ai parlé du Kärcher. Je ne regrette rien [c'est le même homme qui avait déclaré très cyniquement à l'époque : "Kärcher en septembre, 200 000 adhérents [à l'UMP] en novembre"...]. Je suis allé à la rencontre des Français avec dans ma mémoire la douleur des parents de cette jeune fille brûlée vive dans un bus auquel des voyous avaient mis le feu pour s'amuser. J'y suis allé avec dans la tête la voix de ce petit garçon que je tenais par la main devant le cercueil de son père gendarme et qui me tirait par la manche en me disant : "Sors mon papa de la boîte !" J'y suis allé avec devant les yeux l'image de la jeune Ghofrane battue à mort et atrocement torturée parce qu'elle refusait de donner son numéro de carte bleue à ses bourreaux. [...] Je suis allé à la rencontre des Français avec en moi le souvenir de ces familles immigrées, de ces pères, de ces mères, de ces enfants brûlés vifs dans l'incendie de cet hôtel sordide où on les avait entassés parce qu'on n'avait pas les moyens de les loger plus convenablement."
Certains, manifestement majoritaires aujourd'hui, apprécient ce genre de discours ; d'autres, peut-être minoritaires, continuent de ressentir un profond dégoût face à une telle manipulation émotionnelle de l'opinion. Car après avoir suscité l'effroi silencieux de l'assistance, avec tant de malheur et d'horreur exposés, on ne tarde pas à désigner du doigt un coupable - dont il ne viendra à l'idée de personne de contester la culpabilité -, et l'on se présente - tel un messie vengeur - comme celui qui saura le "liquidier"...
Pour une contre-révolution morale
L'ennemi à abattre, c'est l'esprit de Mai 68, ce fantôme persistant, qui, depuis près de quarante ans, plânerait sur la République, et lui empoisonnerait l'âme. Une République comme possédée par le démon de 68, et qui aurait besoin de toute urgence d'un grand "désenvoûtement" mené par notre nouvel exorciste, Sarkozy. Celui-ci emprunte son diagnostic au bon médecin Le Pen, qui imputait déjà à cette date "maléfique" de Mai 68 l'origine du laxisme moral français, par exemple dans ce discours sur la peine de mort du 20 mai 2006 (à la 7e minute). Une bonne introduction au discours terrible de Bercy que tint Sarkozy à la veille du second tour, et dans lequel il se livra à une charge haineuse, d'une violence inouïe, à l'encontre d'un héritage rendu responsable d'à peu près tous nos maux.
Sarkozy (ou plutôt Henri Guaino, l'auteur de ses discours récents) met parfois justement le doigt là où ça fait mal, sur les promesses non tenues de Mai 68 à l'égard des travailleurs, et joue sur les passions tristes de ces derniers : "Sarkozy joue du ressentiment des classes populaires qui se sont senties méprisées par l'idéologie soixante-huitarde", remarque le sociologue Jean-Pierre Le Goff, cité dans Libération du 4 mai 2007. Sa dénonciation du communautarisme soixante-huitard est, en revanche, plus choquante, venant d'un homme qui n'a cessé, ces dernières années, de "communautariser" la France (lire, à ce propos, cette bonne synthèse de l'Observatoire du communautarisme intitulée "Du communautarisme au républicanisme incantatoire : que penser du revirement rhétorique de Nicolas Sarkozy ?"). Carrément culottée enfin, la filiation que Sarkozy établit entre Mai 68 et les 8,5 millions d'euros de prime de départ et de stocks options de Noël Forgeard : "Voyez comment le culte de l'argent roi, du profit à court terme, de la spéculation, comment les dérives du capitalisme financier ont été portés par les valeurs de mai 68. Voyez comment la contestation de tous les repères éthiques, de toutes les valeurs morales [...] a préparé le terrain au capitalisme sans scrupule et sans éthique des parachutes en or, des retraites chapeaux et des patrons voyous..."
Dans Libération du 2 mai 2007, l'historien Henry Rousso, ancien directeur de l'Institut d'histoire du temps présent, rapprochait l'attitude de Sarkozy de celle des contre-révolutionnaires du XIXe siècle, consistant à "voir dans un événement historique révolutionnaire qu'on qualifie de maléfique les causes d'un supposé déclin français". Et de lui rétorquer, sans ménagement : "C'est un argument fantasmagorique, qui ne tient pas sur le plan historique. [...] Faire de 68 la cause unique de toutes les valeurs dominantes aujourd'hui est une absurdité." Selon l'historien, Sarkozy veut définir une culture de droite "en érigeant un ennemi imaginaire. Il reproche à Ségolène Royal et à la gauche de le diaboliser, mais c'est ce qu'il fait : il érige Mai 68 en une sorte de figure du diable... absolument indéfinissable."
Un drôle de moralisateur
L'objectif essentiel que se fixe Nicolas Sarkozy, c'est de mettre en oeuvre "la grande réforme intellectuelle et morale dont la France a une nouvelle fois besoin". De la morale avant toute chose ! "Le mot "morale" ne me fait pas peur. La morale, après mai 68, on ne pouvait plus en parler", lançait Sarkozy à Bercy, lui qui n'a décidément peur de rien. Eh bien parlons-en de morale !
Nicolas Sarkozy veut réhausser "le niveau moral de la politique". Mais est-ce que c'est moral, lorsque l'on est ministre de l'Intérieur et favori de la future élection présidentielle, de pratiquer l'intimidation sur des journalistes ? De faire virer un journaliste du Figaro-Magazine, Joseph Macé-Scaron ? De faire virer le directeur de la rédaction de Paris-Match, Alain Genestar ? De censurer la biographie de sa femme Cécilia, Entre le coeur et la raison ? D'ignorer la séparation des pouvoirs, et de mépriser l'indépendance de la justice ? Est-ce moral de critiquer des Etats-Unis l'arrogance de la France lors de son refus de la guerre en Irak ? Est-ce bien moral d'aller à la pêche aux électeurs frontistes en dénonçant, sur TF1, devant des millions de téléspectateurs, les musulmans qui égorgeraient le mouton dans leur appartement, pour ensuite regretter ces propos, en petit comité, devant une association de jeunes de Nanterre ? Est-ce acceptable de se dire fier de son bilan de ministre de l'Intérieur, sur lequel on prétend être jugé, alors que Alain Bauer, président de l'observatoire national de la délinquance, affirme que "l'indicateur de la violence a continué imperturbablement à monter depuis 1994", et que Sébastian Roché, secrétaire général de la société européenne de criminologie, parle d'un "bilan globalement négatif" ? Est-ce moral, pour l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine (de 1983 à 2002), de n'avoir pas respecté la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) ? Et puis, dire tout et son contraire, est-ce moral ? Et mentir ? (voir cet "article-somme")
Et que dire des allégations du fameux numéro de Marianne de l'avant-premier-tour ? "A entendre les chiraquiens, même ceux qui se sont ralliés à son panache, c'est lui, Sarkozy, qui, ministre du Budget de Balladur, lança la justice sur la piste du scandale des HLM de Paris [...]. Objectif ? Abattre Chirac ! C'est lui encore, prétendent-ils, qui aurait fait révéler, au Canard enchaîné, l'affaire de l'appartement d'Hervé Gaymard, en qui il voyait un adversaire." Ou encore, dans un autre registre : " Se faire, fût-ce en partie, offrir un luxueux appartement aménagé par le promoteur qu'on a systématiquement favorisé en tant que maire, et dans l'espace dont on a, toujours comme maire, financé l'aménagement, est-ce un exemple d'attitude hautement morale ? [...] Publier un livre consacré à l'ancien ministre Georges Mandel qui se révèle, pour partie au moins, être un plagiat coupé-collé de la thèse universitaire de Bertrand Favreau, certaines erreurs comprises, est-ce la quintessence du moralisme intégral ?" Etc. Etc. Il y aurait toute une page de l'hebdomadaire à citer...
Kärchériser Bercy ?
Si Sarkozy n'est pas un parangon de vertu, ses amis politiques ne brillent pas tous non plus par leur probité : Patrick Balkany, Alain Carignon, Gérard Longuet, Alain Juppé, Bernard Tapie ou Charles Pasqua sont des spécimens de choix, qui ont tous eu très sérieusement maille à partir avec la justice. Eric Besson, inconnu du grand public avant la campagne, sera devenu, au terme de celle-ci, l'incarnation même de la traîtrise. Même si la concurrence était rude cette année : entre Tapie, Séguéla, Sevran et Hanin, le choix pouvait demander réflexion...
Tout ce beau monde a donc rejoint la France de TF1... pardon, la France sarkozyste, qui, elle, a réussi à échapper à la décadence morale de notre temps, n'a jamais cédé au "relativisme intellectuel et moral", n'a jamais perdu de vue la "différence entre le beau et le laid", avec des figures de proue comme Steevy du Loft, Miss Dominique de La Nouvelle Star, Doc Gynéco de Nice People (condamné aussi pour fraude fiscale), Richard Virenque et Marielle Goitschel de Je suis une célébrité, sortez-moi de là !, le big boss Arthur, vice-président d'Endemol France, cette merveilleuse société qui nous gratifie des plus belles émissions de la télévision française, qui participent activement à élever le niveau de conscience des futurs électeurs : Loft Story, Nice People, La Ferme Célébrités, 1ere Compagnie, Star Academy, Opération Séduction, 120 minutes de bonheur... sans oublier les sensationnels Véronique Genest de Julie Lescaut, Roger Hanin de Navarro, Bernard Tapie de Commissaire Valence, Henri Leconte et Johnny, nos exilés suisses, et puis Carlos, Thierry Roland, Philippe Candeloro, Rika Zaraï, Michou, Gilbert Montagné (c'est le raffinement de la beaufitude...), on se croirait presque sur le plateau des Enfants de la télé... avec Enrico bien sûr et Christian Clavier (l'autre mauvais sosie de Louis de Funès, lui aussi en beaucoup moins drôle)... et puis Charlotte Rampling, qui fait un peu tache au milieu de toutes ces lumières... et je gardais le meilleur pour la fin : Charles Villeneuve, le déjà mythique présentateur du Droit de savoir, cette émission de TF1 absolument neutre politiquement, qui, entre les deux tours de la présidentielle, le 1er mai, jour de la fête du Travail, aura eu l'ingénieuse idée de programmer un numéro consacré... aux faux chômeurs ! RMIstes fraudeurs ! et malades imaginaires ! Quelle coïncidence de retrouver là les boucs émissaires privilégiés de Nicolas Sarkozy ! Et j'oubliais, dans l'assistance du Palais Omnisports de Paris-Bercy, celui qui détient 42,9 % de la chaîne TF1, Martin Bouygues. La grande famille de "la France d'après" réunie au grand complet !
Un conflit de valeurs
Nicolas Sarkozy a gagné une élection qu'il a placée sous le signe des valeurs - et qui ne se réduisent certes pas à celles qu'incarnent les grands personnnages évoqués à l'instant... Il a voulu qu'on parle "sans complexe" de l'identité nationale. Et cette discussion a créé un sacré malaise, qui se ressent en ce tout début de mandature. Car Nicolas Sarkozy a "joué", là encore, sur ce thème. Il a fait mine de défendre un héritage moral français, alors qu'il n'en défendait en réalité qu'une partie, l'air de rien. En gros, la défense de l'identité nationale s'est réduite, avec lui, à une réponse ferme et sans détour à la "menace" islamiste. "On n'égorge pas le mouton dans son appartement" est la formule choc qui résume toute cette campagne "morale" de Nicolas Sarkozy. Bien sûr, on peut l'enrichir un peu, comme cela a été fait sur Radio-Notre-Dame le 26 avril 2007 : "La polygamie, c'est pas en France, l'excision, c'est pas en France, le voile obligatoire, c'est pas en France, la loi des grands frères qui choisissent les relations de leurs soeurs, c'est pas en France, le père qui oblige la fille à se marier avec quelqu'un, c'est pas en France... Je leur dis tranquillement et simplement, que nul ne doit être condamné à vivre dans un pays qu'il n'aime pas." Si l'on met de côté le ton un brin méprisant utilisé par l'ancien candidat de l'UMP, on peut et on doit même être d'accord sur le fond. Le problème est ailleurs.
D'abord, en prétendant parler d'identité nationale, Sarkozy (incorrigible) montre encore du doigt un bouc émissaire : cette fois, c'est le musulman. Selon le sociologue Emmanuel Todd, cette stratégie classique consistant à désigner des boucs émissaires permet aux responsables politiques incapables de régler les problèmes économiques fondamentaux qui se posent au pays de faire diversion. C'est un aveu (à peine déguisé) d'impuissance. Ensuite, et c'est là que se situe peut-être la plus grosse imposture, Nicolas Sarkozy nous indique, par l'idée même de son ministère de l'immigration et de l'identité nationale, qu'il résume la question de l'identité française à celle de l'assimilation des immigrés ; il réduit cette question, au fond, à l'égalité hommes-femmes et au rejet de certaines coutumes venues d'ailleurs. Emmanuel Todd pointe cette imposture : car la France, c'est aussi "le pays de l'égalité", "du respect de la population", "attaché à des valeurs universalistes", alors que Sarkozy "ne croit pas en l'égalité", "promet d'être dur aux faibles". C'est encore lui "qui est allé faire des génuflexions devant Bush", "qui a trahi la tradition gaulliste". En conséquence de quoi Todd prétend que Sarkozy est "en réel conflit avec l'identité nationale", "ne sait pas ce qu'est la France", et finalement "ne considère pas que Sarkozy aime la France".
On pourrait encore ajouter que la France est un pays profondément attaché à sa laïcité, et que le nouveau président de la République n'a pas montré de très sérieux gages en cette matière cruciale. En témoignent les inquiétudes exprimées par le philosophe Henri Pena-Ruiz, dans une tribune du 15 février 2007 adressée à celui qui était encore ministre de l'Intérieur. Et puis, pour ceux qui auraient déjà oublié les convictions de leur nouveau président en matière religieuse, rafraîchissons-leur la mémoire, avec ces quelques réflexions tirées du livre de Nicolas Sarkozy, La République, les religions, l'espérance, paru en 2004 : "Je crois au besoin de religieux pour la majorité des femmes et des hommes de notre siècle. [...] On ne peut pas éduquer les jeunes en s'appuyant exclusivement sur des valeurs temporelles, matérielles, voire même républicaines. [...] La dimension morale est plus solide, plus enracinée lorsqu'elle procède d'une démarche spirituelle, religieuse, plutôt que lorsqu'elle cherche sa source dans le débat politique ou dans le modèle républicain." Dit autrement : iI est impossible d'éduquer un enfant de façon purement laïque, sans l'assistance nécessaire de la religion. Une vie athée est impensable. On comprend mieux les frictions qui animèrent son entretien avec l'athéiste Michel Onfray...
Puisqu'il faut croire...
Tenant d'une politique économique que d'aucuns qualifient d'ultra-libérale, et qui devrait précariser les moins nantis - si l'on en croit l'analyse du collectif de militants et de chercheurs "L'Autre campagne" et son film Réfutations -, Nicolas Sarkozy a pourtant réussi le tour de force de les ramener à lui, "tous ces sans grade, tous ces anonymes, tous ces gens ordinaires auxquels on ne fait pas attention, que l'on ne veut pas écouter, que l'on ne veut pas entendre", et ce par l'adoption d'une posture autoritaire, de chef, contempteur de la décadence intellectuelle et morale, annonçant la liquidation et la mort de la pensée 68, et le retour aux bonnes vieilles valeurs traditionnelles et religieuses (on se demande, au passage, qui peut bien être ce "on" dans la bouche de Sarko... c'est quand même un homme qui a été ministre de l'Intérieur depuis 2002 et qui était ministre du Budget dès 1993 qui parle... et qui nous avoue donc que, jusqu'ici, il n'a pas fait attention aux gens ordinaires... c'est bien cela qu'il faut comprendre ?). Tour de passe-passe coutumier de toutes les droites dures, et des néoconservateurs américains en particulier. Libéralisme dur dans une main, valeurs morales réactionnaires et autoritarisme liberticide dans l'autre ; la deuxième main vient remédier - très superficiellement - aux maux infligés par la première : d'un côté, on mine la cohésion sociale, on crée du malaise et du désordre, de l'autre, on vient apaiser les âmes désespérées et on mate les perdants - potentiellement réfractaires - du système. Un cocktail classique qui a fait ses preuves, qui endort le pauvre terrorisé et stimule le riche jamais rassasié.
Le climat anxiogène installé par Sarkozy durant sa longue campagne (démarrée il y a cinq ans déjà) perdure dans ces premiers jours de son "ère". La gauche et Libération nous promettent de la casse, des "fractures" ; le Front national, via Alain Soral, nous assure, de son côté, que le programme du nouveau président reprend à 90% le sien propre (dans son pan "économico-social"). Soral, qui n'imagine pas une seconde que Sarkozy le mettra réellement en oeuvre, promet néanmoins, au cas improbable où il le ferait, d'aller "lui baiser les pieds". Fractures promises, convergences "extrémistes"... Pas de quoi rassurer tout le monde. La balle est maintenant dans le camp de Nicolas Sarkozy : saura-t-il devenir le président de tous les Français ? saura-t-il sortir de l'image caricaturale qui lui colle à la peau ? et apaiser l'incroyable défiance d'un nombre considérable de Français, dont rend compte un clip circulant sur Dailymotion, déjà vu plus de deux millions de fois, et redoutablement flippant : Le vrai Sarkozy ? Puisque Nicolas se veut l'apôtre de l'espérance, nous le suivrons sur ce point : nous espérerons en lui, à défaut de croire.
03 mai 2007
Débat présidentiel 2007 : la mante religieuse royale passe à table

Les premières minutes n’ont guère dû rassurer les supporters de la candidate du PS. On interroge, en effet, les deux protagonistes sur leur conception de la présidence. Nicolas Sarkozy, qui est le premier à s’exprimer, répond avec calme et précision. Puis vient le tour de Ségolène Royal, qui se lance dans une tirade assez alambiquée, manifestement hors-sujet, où elle mélange de manière vague tout un tas de problèmes, sorte de bouillie indigeste qui laisse présager du pire. A ce moment précis, on a l’impression de retrouver la Ségolène Royal du début de campagne, quasi inaudible, sortant des phrases fourre-tout d’un ton monotone, et qui laissent franchement perplexe. Bref, à ce moment-là, on se dit que la boucherie annoncée va bel et bien avoir lieu. Et que l’élection est définitivement pliée.
Et puis, petit à petit, l’impensable se produit. La machine Royal se met en route, chauffe doucement, prend progressivement son rythme de croisière, finit par atteindre son rendement optimal, et se transforme bientôt en machine de guerre impitoyable, devant laquelle le soldat Sarkozy se retrouve de plus en plus démuni. Ce basculement se produit insensiblement et se matérialise par l’inversion de la domination en terme de temps de parole. Alors que les premières minutes voient Nicolas Sarkozy faire la course en tête, assez nettement, l’écart se resserre progressivement, jusqu’à ce que Ségolène Royal passe en tête, monopolisant de plus en plus la parole, prenant de plus en plus clairement l’ascendant. Un avantage de temps de parole qu’elle conservera jusqu’au bout, et que Nicolas Sarkozy (gentleman ?) acceptera de lui concéder.
Une histoire de regards
Il n’est pas question ici d’analyser le contenu des discours des deux prétendants à l’Elysée, mais simplement de dire une impression à chaud sur la forme du combat, de dégager un premier ressenti. Des observateurs ont déjà fait remarquer des erreurs factuelles, techniques, de la part des deux candidats. Ségolène Royal nous a ainsi assuré que la part de l’énergie nucléaire dans la production d’électricité en France s’élevait à 17 %, alors qu’elle avoisine plutôt les 78 % ! Nicolas Sarkozy avait, lui, avancé le chiffre (moins fautif) de 50 %. 17 %, cela correspond, en fait, approximativement, à la part de l’énergie nucléaire dans la production d’électricité mondiale. Au final, lequel des deux candidats a commis le moins d’erreurs ? Lequel a tenu le discours le plus sérieux ? Je laisse soin aux observateurs compétents de le mettre en évidence. Mais sur la forme, Royal a gagné sans grande discussion possible, me semble-t-il.
Il a sauté aux yeux de tous que Ségolène Royal n’a cessé de regarder son adversaire dans les yeux, ne déplaçant son regard que rarement vers les deux animateurs, Patrick Poivre d’Arvor et Arlette Chabot. Son regard volontaire et serein tranchait avec celui, très fuyant et mouvant, de Nicolas Sarkozy. L’ancien ministre de l’Intérieur s’adressait manifestement davantage aux deux animateurs, en particulier monsieur Poivre d’Arvor, qu’à sa concurrente, qu’il ne regardait que par intermittence, comme s’il ne parvenait pas à soutenir son regard. On aurait dit qu’il venait chercher une sorte de refuge dans le regard de Poivre, presque un soutien, une amarre pour échapper à sa dérive. Et puis, il y avait ces incessants regards vers la table, ses notes peut-être, qui toujours évitaient madame Royal. Dans cet usage du regard, Nicolas Sarkozy a fait une assez mauvaise impression. A l’inverse, le regard franc et direct de Ségolène Royal lui a fait marquer des points.
On a pu noter aussi une différence de posture. La candidate du PS se tenait, en effet, très droite sur sa chaise, se redressant dès qu’elle se sentait un brin fléchir, tandis que le chef de l’UMP se tenait davantage penché en avant. Ce qui faisait apparaître madame Royal plus haute que monsieur Sarkozy. Physiquement, elle le dominait. Telle une mante religieuse dressée devant sa proie pour la subjuguer, et qu’elle s’apprête à dévorer. Celle en laquelle on ne voyait hier encore qu’une inoffensive "madone" au sourire béat se voyait transformée en une redoutable mante religieuse, mangeuse de Sarkozy...
Maîtresse de la parole
Ségolène Royal a su s’accaparer la parole. Elle a parlé davantage que son adversaire, mais elle a aussi donné l’impression d’avoir beaucoup plus parlé que lui. Souvent, elle a su l’interrompre. Mais, à l’inverse, lorsque celui-ci s’est essayé à la couper, il s’est souvent fait remettre énergiquement à sa place. Sans doute, la féminité de l’élue du Poitou-Charentes a-t-elle ici constitué un avantage : interrompre madame Royal, sans tenir compte de ses protestations, aurait pu passer pour de l’odieux machisme, et c’était là le piège qui était, à l’évidence, à éviter.
Si Ségolène Royal a donné l’impression d’avoir bien plus parlé que Nicolas Sarkozy, c’est aussi parce qu’elle a mieux parlé que lui ; et là réside la grande surprise de ce débat. Il était communément admis que Ségolène Royal était une très piètre oratrice, pour ne pas dire pire... On tremblait pour elle, dès qu’elle débutait une phrase, de peur qu’elle ne s’écroule, qu’elle perde le fil de sa pensée. On sentait une fragilité. Sa parole n’était pas sûre. Et, pour ma part, je dois confesser avoir eu beaucoup de mal à m’intéresser à elle durant cette campagne présidentielle, ayant éprouvé beaucoup de difficulté à l’écouter durant ne serait-ce que quelques secondes... Je n’y prenais rigoureusement aucun plaisir. Ce mercredi soir, mis à part quelques envolées incertaines, quelques (rares) phrases qu’il vaudrait mieux ne pas avoir à relire à l’écrit, Ségolène Royal s’est bien exprimée, parfois même assez remarquablement. Elle a fait impression.
Une parole sûre, franche, marquée d’un volontarisme très puissant, face à laquelle celle de Nicolas Sarkozy, plus simple et pragmatique, paraissait pauvre et manquant quelque peu de grandeur, de souffle. En écoutant Royal, on imaginait entendre la présidente de la République. La transfiguration avait déjà eu lieu. Sarkozy, ce soir, n’a pas su atteindre la même dimension. Sans doute Ségolène Royal s’est-elle nourrie de l’incroyable énergie qui lui a été donnée la veille de ce débat, lors de son meeting-concert à Charléty, rassemblement populaire assez inouï, qui avait drainé entre 60 000 et 80 000 sympathisants (à l’intérieur et à l’extérieur du stade), et qui pouvait rappeler la ferveur qui accompagnait les plus grands matchs de l’équipe de France de Zidane en Coupe du monde. La piètre oratrice qu’on connaissait jusque-là avait déjà eu l’occasion de faire montre de ses incroyables progrès, en emportant l’enthousiasme d’un immense public.
L’inversion des rôles
Reste à savoir si Ségolène Royal a bluffé lors de ce débat. Car sur certaines questions techniques, face auxquelles le téléspectateur de base est dépourvu et ne peut guère juger par lui-même, elle a fait la leçon à Nicolas Sarkozy. Celle dont on raillait l’incompétence a joué, à maintes reprises, la maîtresse d’école du petit Nicolas, qui, d’après elle, avait mal appris sa leçon (tandis que ce dernier usait fréquemment de cette étrange expression, un brin enfantine : "c’est pas gentil"). On peut relever, à ce propos, leur polémique autour du nucléaire (où il y avait, en l’occurrence, erreur des deux, et notamment de la "maîtresse"). Ségolène Royal a eu l’audace d’accuser son adversaire d’incompétence, et cette singulière stratégie a semblé le décontenancer. Vers le milieu du débat, on a pu sentir Sarkozy proche de la déroute, pétrifié par l’attitude offensive, voire guerrière, de sa "challengeuse". L’incompétente présumée se métamorphosait (ou faisait mine de se métamorphoser) en experte, et assommait son adversaire, présumé expert, qui restait médusé.
Et puis il y eut ce moment fort, cette colère de Ségolène Royal en réaction à la proposition de Nicolas Sarkozy d’un "droit opposable" qui permettrait aux parents d’enfants handicapés de les inscrire dans des écoles "classiques". La candidate socialiste fit remarquer que le gouvernement auquel appartenait Nicolas Sarkozy avait supprimé des milliers d’emplois d’aides-éducateurs, ainsi que le plan Handiscol, qu’elle avait mis en place, et qui permettait précisément d’intégrer les enfants handicapés à l’école. Elle mit énergiquement en cause l’exploitation sentimentale que son concurrent opérait, selon elle, sur le thème du handicap, allant jusqu’à parler de "summum de l’immoralité politique".
Nicolas Sarkozy ne manqua pas de sauter sur l’occasion pour rappeler qu’un chef d’Etat se doit de rester calme et de ne jamais perdre ses nerfs - c’était l’hôpital qui se moquait de la charité... Mais "il y a des colères très saines", rétorqua justement madame Royal, qui avait gardé son sang-froid, quoi qu’en ait dit son adversaire. Le chef de l’UMP, tellement attentif à ne pas déraper, à ne pas se montrer agressif et nerveux, pour contrer les attaques récentes touchant sa personnalité, s’en est montré presque trop terne ; sa contenance s’est avérée presque excessive. En comparaison, l’émotion mise dans ses mots par Ségolène Royal pouvait facilement passer pour de l’emportement.
On notera, au passage, cette savoureuse remarque de Sarkozy, demandant à sa concurrente de ne pas le pointer du doigt avec son index, lui qui est justement coutumier de ce genre de menaces, l’index pointé, notamment en direction des journalistes qui ne lui sont pas assez favorables. On notera encore, à un autre moment du débat, cette remarque sarkozyste, tout aussi pittoresque, sur la nécessité, pour un responsable politique, de tenir un langage mesuré et de ne jamais user de "mots qui blessent", par lesquels "on divise son peuple" au lieu de le rassembler... Le Kärcher et la racaille étaient alors manifestement effacés de sa mémoire. Ségolène Royal, peut-être consciente que ces termes avaient largement participé à sa popularité, eut la bonne idée de ne pas les lui rappeler.
Une victoire pour rien ?
D’un point de vue tactique, Nicolas Sarkozy aura cherché à susciter un certain apaisement autour de sa personne, en mettant en oeuvre un self-control assez inédit chez lui, n’hésitant pas à dire ses points d’accord avec sa rivale socialiste. Cette dernière, donnée perdante par tous les sondages, avait pour obligation de partir à l’abordage, de "rentrer dans le lard" de son adversaire, de lui marcher dessus. Elle a rempli son contrat, avec une audace et un aplomb qu’on ne lui soupçonnait guère - à ce point. Sarkozy a cherché à ne pas perdre, il a voulu gérer son avance. Il a voulu éviter le dérapage qui l’aurait plombé et fait dévier de sa trajectoire toute tracée vers l’Elysée, qui aurait compromis, à seulement quatre jours de l’arrivée, son sacre annoncé, brisé son fabuleux "destin en marche". Royal a joué le tout pour le tout et a déjoué tous les pronostics qui la donnaient fatalement perdante pour ce débat. Pour user d’une métaphore sportive, Sarkozy a joué "petit bras", tandis que Royal a exercé sur son adversaire un "pressing" de tous les instants, en jouant très haut.
De mon modeste point de vue, Ségolène Royal a remporté cette confrontation, dans la forme en tout cas, dans l’impression générale produite, et cela assez haut la main. Certes, son tout début de débat m’est apparu laborieux, et la fin de sa prestation avait perdu en intensité (comme celle de Sarkozy d’ailleurs, le débat ayant été un brin longuet...), mais elle seule a su incarner, durant plus de 2h30, la fonction présidentielle avec prestance. On aurait parfois dit François Mitterrand réincarné en femme... Bien sûr, je néglige là le fond des programmes, qui est ce qui doit prédominer dans nos considérations. Mais au terme d’un tel débat, plus que quelques questions de fond, il reste surtout une impression, un sentiment. Et force est de constater que Ségolène Royal a remporté ce combat de pure forme. Je suis le premier surpris de cette victoire, même si je la sentais venir depuis quelques jours, et surtout le choc du meeting de Charléty.
Les experts en matière de débat présidentiel nous assurent que cet exercice, certes toujours très attendu par les Français, ne joue quasiment aucun rôle dans le scrutin, et qu’une émission ne fait pas basculer une élection. Dans ce cas, Nicolas Sarkozy sera élu dimanche prochain, dans un fauteuil. C’est l’hypothèse qui demeure la plus probable. Mais qui aurait pensé que le débat de l’entre-deux-tours pourrait prendre une telle tournure ? Personne. D’ici dimanche à 20 heures, le vent pourrait donc encore tourner...
01 mai 2007
Effervescence à Charléty pour la venue de Ségolène Royal
Incontestablement, Ségolène Royal finit sa campagne présidentielle bien mieux qu'elle ne l'avait commencée. Plus à l'aise dans ses discours, elle parvient même maintenant à transporter les foules. Au stade Charléty, pour ce 1er mai et son dernier meeting, à la veille de son débat télévisé face à Nicolas Sarkozy, elle a amené à elle plus de 60 000 sympathisants (peut-être 80 000), dont près de la moitié ont dû rester à l'extérieur du stade archi bondé, sur les boulevards Jourdan et Kellermann, noirs de monde.
On a pu assister à des scènes absolument dingues : des dizaines, voire des centaines de personnes de tous âges, hommes et femmes, ont pris d'assaut les grilles du stade, hautes de près de trois mètres, et les ont escaladées, pour assister à tout prix à l'événement ! Les gardes de CRS, d'abord dépassées par cet enthousiasme imprévu, finirent par former une ceinture de sécurité tout autour du stade, pour stopper cette ruée un brin anarchique. Nul doute qu'en ce 1er mai, la candidate socialiste aurait pu remplir sans peine le Stade de France.
Contraste saisissant entre ce grand rassemblement populaire, bigarré, fraternel et à ciel ouvert, sous un merveilleux soleil de printemps, qui pouvait faire penser à une communion nationale telle qu'on peut en connaître lors des grands matchs de Coupe du Monde, et le show à l'américaine de Sarkozy et de ses amis, renfermés dans la bulle du Palais Omnisports de Paris-Bercy comme dans un bunker, démonstration de force et d'arrogance avant toute chose, et dans laquelle la fraternité était la grande absente.
Alors que Sarkozy avait craché dimanche dernier sur l'héritage de Mai 68, avec lequel il veut définitivement en finir après son élection, Royal l'a réhabilité, ironisant même sur les velléités de son concurrent de replonger la France dans le trouble social pour pouvoir y mettre de l'ordre : "Mais Doc Gynéco, ce n'est pas André Malraux. François Mauriac, ce n'est pas Bernard Tapie. Et monsieur Sarkozy ce n'est pas le général de Gaulle" - une pique savoureuse qui a ravi la foule joyeuse. Ségolène Royal a rappelé, au passage, l'origine de la fête du 1er mai - histoire d'ancrer son discours clairement à gauche.
Un vent de victoire soufflait chaleureusement dans les drapeaux, les âmes et les coeurs. C'était un 1er mai à Charléty. 60 000 hommes et femmes rêvaient. A une autre France que celle que nous préparent la droite et son champion. La dure réalité du scrutin n'avait pas encore frappé. L'espoir vivait. Renaud était là, bien sûr, comme Noah, comme beaucoup d'autres : Higelin, Moustaki, Delpech, Bénabar, Damien Saez, Les Têtes Raides, Cali, Kerry James, Disiz la Peste, Grand Corps Malade... Le triomphe sarkozyste, annoncé par les sondages, était oublié, et cet oubli était bon.




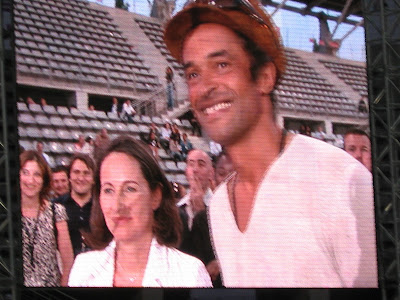


C’est Renaud et Yannick Noah qui ont conclu le concert, en présence de Ségolène Royal. Renaud a interprété "C'est pas l'homme qui prend la mer" et "Hexagone" :
Et Yannick Noah a notamment chanté "Donne-moi une vie" :