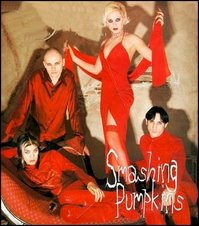Entre ses mains, un film d’Anne Fontaine
Dans les eaux troubles du désir
Un homme, Laurent, interprété par Benoît Poelvoorde, rencontre une femme, Claire, jouée par Isabelle Carré. Ça se passe sur le lieu de travail de cette dernière, une compagnie d’assurances ; Laurent, vétérinaire, est victime d’un dégât des eaux et c’est Claire qui est en charge de son dossier. Très vite, Laurent initie avec Claire une relation, pas encore intime, mais plus personnelle qu’elle ne devrait l’être et le rester. Il joue sur son humour et l’on retrouve là le Benoît Poelvoorde que l’on connaît, au pouvoir comique irrésistible, malgré le cadre « film sérieux » dans lequel on se trouve là. Mais déjà, dès les premières minutes, quelque chose d’autre se dégage, quelque chose d’inhabituel, qui laisse présager un grand film. Car disons-le tout net et sans attendre : ce film est grand, il est profond, il est même exceptionnel. Poelvoorde déploie des talents d’acteur, certes pas insoupçonnés, mais révélés clairement ici au grand jour, précisément dans le clair-obscur de ce face à face avec une Isabelle Carré au sommet de son art. Ce film est un film d’atmosphère, c’est un film physique, que l’on ressent avec force ; on est constamment pris par des sentiments complexes et hésitants : faut-il penser ceci, faut-il penser cela ? En attendant, on ressent, et ce que l’on ressent est troublant et envoûtant.
L’élément dramatique qui tend l’atmosphère, qui la charge d’électricité, c’est qu’un tueur en série agit sur Lille (cadre de ce film), un tueur de femmes, amateur de scalpel. Et très tôt, on se demande – avec Claire – si ce n’est pas ce Laurent, vétérinaire qui précisément manie le scalpel, qui est l’assassin. Car ce Laurent a une personnalité ambiguë : il est drôle parfois, dragueur souvent, chasseur même, mais chasseur d’intimité plus que de sexe, il se fait sombre aussi à d’autres moments, silencieux, manifestement perturbé. Il a réussi en peu de temps à nouer une relation très étroite avec Claire, cette femme qui incarne la normalité même ; mariée, un enfant, avec son petit train-train heureux, son équilibre, et ce fauve tendre et drôle, Laurent, qui pénètre dans sa vie, et qui va la changer, qui va la faire douter, de sa vie, peut-être de son couple, qui va la faire revivre, la faire rire, la troubler, l’intriguer, lui faire battre le cœur. Claire finit par retrouver une seconde jeunesse avec ce mystérieux personnage, qui ne cesse de lui témoigner de son intérêt, qui se dévoile de plus en plus, qui laisse entrevoir ses failles et ses plaies encore ouvertes ; elle se demande si elle est en danger, entend parler régulièrement des méfaits du tueur, mais ça ne l’arrête pas ; on la voit s’éloigner de son mari, terne figure bien trop rassurante pour une femme qui rêve encore et qui touche du doigt l’aventure et l’excitation d’être vivante. La trop lisse Claire sombre dans ses propres profondeurs, Laurent est son révélateur, et c’est pour cela qu’elle l’aime, car elle l’aime finalement, elle tombe amoureuse ; mais rien ne se passe entre eux, Laurent recule et fuit dans ses secrets. Et aligne cul sec les verres de vodka.
Un épisode furtif rassure Claire : le tueur présumé a été arrêté, et ce n’est pas Laurent. Que faisait donc ce scalpel dans la poche de son manteau, qu’elle avait découvert un soir de sortie avec lui dans une boîte de nuit ? Cette question, elle cesse de se la poser. La peur s’est estompée. Jusqu’à ce qu’elle retrouve, épouvantée, sa meilleure amie, qui est aussi sa collègue, morte, égorgée, victime du tueur – qui court donc toujours. Or, Laurent la connaissait. Il l’avait rencontrée peu de temps auparavant. Et un verre de vodka se trouve là, sur les lieux du drame. Claire n’a dès lors plus aucun doute ; ce qu’elle pressent en fait depuis le début est maintenant on ne peut plus clair : Laurent est le tueur. L’effroi la reprend, la terreur. Mais devant le policier qui l’interroge, elle ne dit rien. De retour à son travail, on la voit paniquée, elle aperçoit Laurent au réfectoire – réalité ou hallucination ? – et va s’enfermer dans son bureau, en larmes ; elle téléphone à son mari, lui demande de venir la chercher en fin de journée. Mais le soir, le mari met du temps à venir et Laurent arrive avant lui. Les masques tombent. « Tu le savais depuis le début, pourquoi n’as-tu rien fait ? », demande-t-il, avant de la supplier : « Aide-moi… » Laurent attend-il autre chose que Claire ne le dénonce et l’arrête enfin, stoppe sa course folle dans la mort, mette un terme à sa souffrance, à sa perdition ? Laurent s’en va, on sent Claire complètement désorientée, on voit son mari qui arrive enfin, mais Claire ne le rejoint pas. Sa vie est ailleurs. Son amour aussi. Laurent est rentré dans son cabinet de véto ; c’est la pénombre, la nuit noire, la nuit des âmes en sursis. Claire a marché dans ses pas, elle est là, dans la pénombre du cabinet, derrière lui, à deux pas du tueur, qui peut-être la menace. Que fait-elle ici ? La femme toute normale qu’elle était aurait jadis appelé la police et serait allée se réfugier dans les bras de son mari. Mais l’âme et le corps de Claire sont maintenant comme aimantés par ceux de Laurent. Son destin est lié au sien. Le tueur de sa meilleure amie est là, l’effroi est clairement là, et pourtant l’amour s’y mêle encore – et tout cela sonne terriblement vrai. Laurent va-t-il tuer Claire ? Ou est-ce Claire qui va tuer Laurent ? Ou alors est-ce l’amour – insensé – qui va sauver l’homme perdu ?
Les deux êtres se font face, ils se rapprochent, tout cela est très fort, ils s’embrassent, ils fusionnent. Laurent, que l’on voyait jusque-là incapable d’embrasser Claire ou une autre femme, freiné par une irrépressible tension, se laisse ici aller, tout semble se dénouer, ses mains ne se crispent pas autour de son cou, elles glissent. Mais bientôt, ses vieux démons le reprennent ; non, Laurent ne s’en sortira jamais. Il a sorti son scalpel, l’a posé sur la gorge de Claire, il s’est remis à haleter comme un malade, il est sur le point de la tuer, mais ne peut s’y résoudre. Lui aussi est tombé réellement amoureux – pour la toute première fois. Poelvoorde est ici magnifique et pathétique. Laurent, on le devine, retourne alors son arme contre lui. L’avant-dernier plan du film nous montre les deux amants (il faut bien les appeler ainsi), Laurent assis par terre et ensanglanté, mais encore vivant, et Claire à ses côtés. Au dernier plan, Claire marche seule, dehors, dans la nuit, sous les éclairages publics de Noël, face à la grande roue au sommet de laquelle elle avait pour la dernière fois ri avec lui.
Dans les eaux troubles du désir
Un homme, Laurent, interprété par Benoît Poelvoorde, rencontre une femme, Claire, jouée par Isabelle Carré. Ça se passe sur le lieu de travail de cette dernière, une compagnie d’assurances ; Laurent, vétérinaire, est victime d’un dégât des eaux et c’est Claire qui est en charge de son dossier. Très vite, Laurent initie avec Claire une relation, pas encore intime, mais plus personnelle qu’elle ne devrait l’être et le rester. Il joue sur son humour et l’on retrouve là le Benoît Poelvoorde que l’on connaît, au pouvoir comique irrésistible, malgré le cadre « film sérieux » dans lequel on se trouve là. Mais déjà, dès les premières minutes, quelque chose d’autre se dégage, quelque chose d’inhabituel, qui laisse présager un grand film. Car disons-le tout net et sans attendre : ce film est grand, il est profond, il est même exceptionnel. Poelvoorde déploie des talents d’acteur, certes pas insoupçonnés, mais révélés clairement ici au grand jour, précisément dans le clair-obscur de ce face à face avec une Isabelle Carré au sommet de son art. Ce film est un film d’atmosphère, c’est un film physique, que l’on ressent avec force ; on est constamment pris par des sentiments complexes et hésitants : faut-il penser ceci, faut-il penser cela ? En attendant, on ressent, et ce que l’on ressent est troublant et envoûtant.
L’élément dramatique qui tend l’atmosphère, qui la charge d’électricité, c’est qu’un tueur en série agit sur Lille (cadre de ce film), un tueur de femmes, amateur de scalpel. Et très tôt, on se demande – avec Claire – si ce n’est pas ce Laurent, vétérinaire qui précisément manie le scalpel, qui est l’assassin. Car ce Laurent a une personnalité ambiguë : il est drôle parfois, dragueur souvent, chasseur même, mais chasseur d’intimité plus que de sexe, il se fait sombre aussi à d’autres moments, silencieux, manifestement perturbé. Il a réussi en peu de temps à nouer une relation très étroite avec Claire, cette femme qui incarne la normalité même ; mariée, un enfant, avec son petit train-train heureux, son équilibre, et ce fauve tendre et drôle, Laurent, qui pénètre dans sa vie, et qui va la changer, qui va la faire douter, de sa vie, peut-être de son couple, qui va la faire revivre, la faire rire, la troubler, l’intriguer, lui faire battre le cœur. Claire finit par retrouver une seconde jeunesse avec ce mystérieux personnage, qui ne cesse de lui témoigner de son intérêt, qui se dévoile de plus en plus, qui laisse entrevoir ses failles et ses plaies encore ouvertes ; elle se demande si elle est en danger, entend parler régulièrement des méfaits du tueur, mais ça ne l’arrête pas ; on la voit s’éloigner de son mari, terne figure bien trop rassurante pour une femme qui rêve encore et qui touche du doigt l’aventure et l’excitation d’être vivante. La trop lisse Claire sombre dans ses propres profondeurs, Laurent est son révélateur, et c’est pour cela qu’elle l’aime, car elle l’aime finalement, elle tombe amoureuse ; mais rien ne se passe entre eux, Laurent recule et fuit dans ses secrets. Et aligne cul sec les verres de vodka.
Un épisode furtif rassure Claire : le tueur présumé a été arrêté, et ce n’est pas Laurent. Que faisait donc ce scalpel dans la poche de son manteau, qu’elle avait découvert un soir de sortie avec lui dans une boîte de nuit ? Cette question, elle cesse de se la poser. La peur s’est estompée. Jusqu’à ce qu’elle retrouve, épouvantée, sa meilleure amie, qui est aussi sa collègue, morte, égorgée, victime du tueur – qui court donc toujours. Or, Laurent la connaissait. Il l’avait rencontrée peu de temps auparavant. Et un verre de vodka se trouve là, sur les lieux du drame. Claire n’a dès lors plus aucun doute ; ce qu’elle pressent en fait depuis le début est maintenant on ne peut plus clair : Laurent est le tueur. L’effroi la reprend, la terreur. Mais devant le policier qui l’interroge, elle ne dit rien. De retour à son travail, on la voit paniquée, elle aperçoit Laurent au réfectoire – réalité ou hallucination ? – et va s’enfermer dans son bureau, en larmes ; elle téléphone à son mari, lui demande de venir la chercher en fin de journée. Mais le soir, le mari met du temps à venir et Laurent arrive avant lui. Les masques tombent. « Tu le savais depuis le début, pourquoi n’as-tu rien fait ? », demande-t-il, avant de la supplier : « Aide-moi… » Laurent attend-il autre chose que Claire ne le dénonce et l’arrête enfin, stoppe sa course folle dans la mort, mette un terme à sa souffrance, à sa perdition ? Laurent s’en va, on sent Claire complètement désorientée, on voit son mari qui arrive enfin, mais Claire ne le rejoint pas. Sa vie est ailleurs. Son amour aussi. Laurent est rentré dans son cabinet de véto ; c’est la pénombre, la nuit noire, la nuit des âmes en sursis. Claire a marché dans ses pas, elle est là, dans la pénombre du cabinet, derrière lui, à deux pas du tueur, qui peut-être la menace. Que fait-elle ici ? La femme toute normale qu’elle était aurait jadis appelé la police et serait allée se réfugier dans les bras de son mari. Mais l’âme et le corps de Claire sont maintenant comme aimantés par ceux de Laurent. Son destin est lié au sien. Le tueur de sa meilleure amie est là, l’effroi est clairement là, et pourtant l’amour s’y mêle encore – et tout cela sonne terriblement vrai. Laurent va-t-il tuer Claire ? Ou est-ce Claire qui va tuer Laurent ? Ou alors est-ce l’amour – insensé – qui va sauver l’homme perdu ?
Les deux êtres se font face, ils se rapprochent, tout cela est très fort, ils s’embrassent, ils fusionnent. Laurent, que l’on voyait jusque-là incapable d’embrasser Claire ou une autre femme, freiné par une irrépressible tension, se laisse ici aller, tout semble se dénouer, ses mains ne se crispent pas autour de son cou, elles glissent. Mais bientôt, ses vieux démons le reprennent ; non, Laurent ne s’en sortira jamais. Il a sorti son scalpel, l’a posé sur la gorge de Claire, il s’est remis à haleter comme un malade, il est sur le point de la tuer, mais ne peut s’y résoudre. Lui aussi est tombé réellement amoureux – pour la toute première fois. Poelvoorde est ici magnifique et pathétique. Laurent, on le devine, retourne alors son arme contre lui. L’avant-dernier plan du film nous montre les deux amants (il faut bien les appeler ainsi), Laurent assis par terre et ensanglanté, mais encore vivant, et Claire à ses côtés. Au dernier plan, Claire marche seule, dehors, dans la nuit, sous les éclairages publics de Noël, face à la grande roue au sommet de laquelle elle avait pour la dernière fois ri avec lui.
Le film est intense, il sonne vrai ; il nous plonge au cœur de sentiments pour le moins complexes, nous fait nous mouvoir sur les noires allées de l’âme humaine – rarement explorées –, dans les tréfonds incompréhensibles du désir. On souffre pour Laurent, malgré l’horreur de ses crimes, on apprécie son humanité désarticulée et l’on suit, stupéfait, les effets qu’il produit sur la douce et jolie et bien trop normale Claire, qui, sans jamais quitter complètement sa normalité, fait l’expérience de la face trouble qui est la sienne et qui la tenaille et la tiraille. Les deux acteurs centraux du film sont magistraux ; Poelvoorde, en particulier, est époustouflant, fascinant. L’émotion et la profondeur qu’il dégage sont assez inouïes. La sage Isabelle Carré, si lointaine a priori de l’univers du show man belge, se révèle son pendant parfait pour incarner cette histoire de passion et de folie au cœur de la plus stricte banalité. Qualifier ce film d’Anne Fontaine de chef-d’œuvre ne serait sans doute pas usurpé. Contentons-nous de dire qu’il s’agit sans conteste de l’un des meilleurs films français de ces dernières années. 9,50 euros la place ? C’est clairement là l’un des rares films qui ne nous fasse pas regretter un tel investissement. Il est des films qui peinent à vous divertir ; celui-ci divertit, dans le sens où l’on ne songe à rien d’autre durant les 1 heure 30 de son déploiement, mais en plus il nourrit, il enrichit ; on en sort conscient d’avoir assisté à un moment rare, d’où le cinéma sort grandi – et nous avec.
Technorati Tags : Cinéma, Poelvoorde