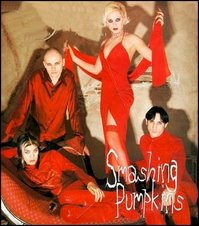Mercredi 24 janvier 2007, Laurent Bazin, journaliste à i>TELE, a annoncé qu'il fermait son blog. Ouvert il y a seulement trois mois, celui-ci avait pour ambition d'être un lieu de liberté de parole et d'échange avec les internautes. Cette belle entreprise s'est avérée "impossible" à poursuivre, sans risquer de mettre en péril la carrière du journaliste. Laurent Bazin doit, pour sa tranquillité, rentrer dans le rang. Un micro-événement pour le moins inquiétant.
Dans une note intitulée "Voilà, c'est (déjà) fini", Laurent Bazin explique à ses lecteurs les raisons de la fermeture précipitée de son blog, le pourquoi de cette capitulation : "Il m'est en effet impossible de continuer l'exercice de transparence que je m'étais imposé le 16 novembre dernier en entamant ce dialogue avec vous. Je réalise aujourd'hui, sans doute trop tard, qu'en vérité on ne peut pas "tout publier". Formidable naïveté de ma part, presqu'inquiétante diront certains après vingt ans de métier." Naïveté... Formidable... Inquiétante... Après vingt ans de métier... Il y a quelque chose d'assez bouleversant dans ces mots. Dans la croyance qu'avait conservée, malgré une expérience déjà longue, ce journaliste intègre en la noblesse de son métier, un métier - voire une mission - qui prétend (dans l'idéal) "porter le fer dans la plaie", chercher le vrai et le dire, malgré les risques et les pressions, passant outre tous les inconforts. Laurent Bazin croyait, via son blog, pouvoir demeurer un saint homme de l'information ; il a dû se résoudre, au final, après trois mois d'aventure, à reconnaître qu'il était avant tout un salarié. Qui ne fait pas absolument ce qu'il veut. Qui n'est pas en mission. Mais qui bosse, pour un boss, qui fixe les règles, et qui a ses intérêts propres, auxquels doit se plier le petit soldat de l'information s'il veut rester en place. Le ventre commande, et les beaux idéaux s'y plient. On le comprend.
On ne peut donc pas "tout publier". On le savait déjà, c'est vrai. Mais qu'a bien pu révéler notre ex-journaliste-blogueur pour subir les pressions qui l'auront fait capituler aussi vite ? Des secrets d'Etat ? Les frasques extra-conjugales de nos candidats à la présidence ? Même pas. Laurent Bazin écarte ces pistes d'une phrase sèche : "Nicolas, Segolène et les autres n'y sont pour rien." Alors quoi ? En fait, le journaliste s'est heurté à... ses propres confrères : "Ce sont mes confrères qui ont le plus souffert." Il en a ainsi "blessé" certains, "exaspéré" d'autres, a enfin "déclenché la colère" des derniers. Le parti-pris de la transparence ne leur était manifestement pas bien familier... Autant d'inimitiés suscitées par une entreprise somme toute assez saine, cela a de quoi refroidir quelque peu les ardeurs des plus enthousiastes.
On ne peut donc pas "tout publier". On le savait déjà, c'est vrai. Mais qu'a bien pu révéler notre ex-journaliste-blogueur pour subir les pressions qui l'auront fait capituler aussi vite ? Des secrets d'Etat ? Les frasques extra-conjugales de nos candidats à la présidence ? Même pas. Laurent Bazin écarte ces pistes d'une phrase sèche : "Nicolas, Segolène et les autres n'y sont pour rien." Alors quoi ? En fait, le journaliste s'est heurté à... ses propres confrères : "Ce sont mes confrères qui ont le plus souffert." Il en a ainsi "blessé" certains, "exaspéré" d'autres, a enfin "déclenché la colère" des derniers. Le parti-pris de la transparence ne leur était manifestement pas bien familier... Autant d'inimitiés suscitées par une entreprise somme toute assez saine, cela a de quoi refroidir quelque peu les ardeurs des plus enthousiastes.
Mais que devient l'idéal du journaliste ? Peut-on le jeter si facilement aux orties ? "Mais je suis un salarié, nous répond Bazin, mon entreprise a des actionnaires et des intérêts et - sauf à vouloir jouer les chevaliers blancs - je ne peux continuer à mener parallèlement ces deux vies éditoriales." Une déclaration qui a le mérite de la franchise. Alors qu'en novembre dernier, Loïc Le Meur prophétisait la fin du "off" pour les politiques, la déconvenue de Laurent Bazin - qui s'était fait une spécialité sur son blog de trahir les "off" -, indique clairement que la transparence pour les journalistes n'est pas encore d'actualité. C'est que tout le monde se tient : "On est toujours en connivence avec quelqu'un... On se retient toujours de livrer une information dont on ne se priverait pas si il s'agissait d'un inconnu. Tant que l'on est salarié, que l'on travaille avec une équipe, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est comme ça." La transparence n'était qu'un rêve (ou un cauchemar). Les relations humaines élémentaires s'y opposent. Tension sans résolution simple entre l'humain et l'exigence du vrai.
Et Laurent Bazin de saluer ses lecteurs, un peu orphelins de sa liberté ce mercredi matin : "Merci à tous ceux qui avaient trouvé ici un espace de discussion. J'ai aimé votre liberté de ton, j'ai été surpris aussi par la violence de vos mises en cause. Vous pouvez vous payer ce luxe. Moi pas. En tout cas pas sous cette forme là." Luxe. Qu'on peut se payer ou pas. La vérité, espérons-le, saura emprunter d'autres chemins...
Audace, insolence... inconscience ?
Je ne peux m'empêcher de mettre en rapport le billet de clôture du blog de Laurent Bazin avec cet autre billet, très osé, qu'il avait écrit le 7 décembre 2006, intitulé "Ne tirez pas sur le lampiste...". Peut-être se heurtait-il là aux limites qu'un journaliste ne doit pas dépasser. Il s'en prenait alors, sans ambages, à la fois à ses confrères journalistes et aux hommes politiques : "Je crois profondément que les politiques ne se sauveront pas en accusant artificiellement les journalistes de ne rien comprendre aux vraies aspirations du pays et que les journalistes n'iront pas bien loin non plus s'ils se contentent de servir la soupe aux candidats et changer de cheval au gré du vent. Je crois qu'on ne respecte pas ceux qui vous sont acquis. Et que rentrer dans ce jeu, c'est se condamner à n'être plus respectable. Je crois aussi que c'est aux politiques d'agir et qu'ils ne peuvent pas continuer à accuser les journalistes de ne rien comprendre sous pretexte que la colère des électeurs gronde." Remontrance pour le moins vigoureuse... Les politiques ont, en effet, parfois la fâcheuse tendance - qu'ils partagent d'ailleurs avec les blogueurs - de taper sur les journalistes, car c'est à la mode, c'est plutôt "tendance". Ça peut sans doute rapporter quelques suffrages de plus. Mais les journalistes sont aussi un peu responsables de ce mauvais traitement qui leur est fait : s'ils ne font que "servir la soupe aux candidats" ? S'ils ne font que "changer de cheval au gré du vent" ? "Rentrer dans ce jeu, c'est se condamner à n'être plus respectable." Sentence terrible de Bazin. Mais tellement lucide. Pour ne plus servir de défouloirs aux politiques - et aux blogueurs et autres "journalistes citoyens" -, les journalistes de métier devraient sans doute avoir le courage dont a fait montre Laurent Bazin durant trois mois sur son blog, en osant parler vrai. La fin de son entreprise, hier, n'a pas de quoi rendre optimiste pour l'avenir de la presse...
Toute cette note du 7 décembre 2006 mériterait d'être citée, pour sa liberté de ton et sa clairvoyance : "Je lis vos commentaires et je suis frappé de voir combien la critique des médias est devenue courante, quotidienne, le mépris parfois systématique. [...] A mon niveau, je n'ignore évidemment pas les petites - et parfois les grandes - compromissions de certains. La complicité passée ou présente qui unit les uns ou les autres. Les petits arrangements ou les grandes réconciliations qui ont rythmé l'histoire agitée du couple Politiques/journalistes et Politiques/Industriels."
Et voici alors parti notre kamikaze de l'information dans une critique acérée de Nicolas Sarkozy et de Paris-Match, pointant du doigt le récent retournement de l'hebdomadaire, qui, un an après avoir froissé le Premier Flic de France en publiant une photo de sa femme au bras de son amant, nous offrait un numéro à sa gloire qui est resté dans toutes les mémoires, évoquant "un destin en marche". "Faut-il y voir le résultat d'un marchandage ? D'un changement de ligne éditoriale ? Une contrepartie ou une façon de s'excuser d'avoir été trop loin ?", s'interroge Bazin. "Une seule certitude : entre la Une sur Cécilia et la Une sur Nicolas, le directeur de la Rédaction de Match, Alain Genestar, a été remercié par son actionnaire. Nicolas Sarkozy a été tellement furieux de voir cette photo en couverture d'un journal du groupe Lagardère que pendant des semaines, il n'a plus pris au téléphone ni son propriétaire, Arnaud, ni Jean-Pierre Elkabach (patron d'Europe1, de Public Sénat et administrateur du groupe sus-nommé) dont il est si proche. Une brouille ostensible. Presque un début de guerre..." Et de dresser le portrait assez effrayant de "celui que le tout Paris considère comme "l'homme qui a une chance sur deux de devenir président de la République". Un homme à craindre et qui sait en imposer aux rédactions comme à ses collègues ministres." Sans oublier de taper sur les confrères, en dénonçant leur incorrigible lâcheté : "Et cette Une est sans doute un exemple frappant de cette pusillanimité qui reste le fort de certains journalistes et patrons de presse. Toujours avec les loups, gorge offerte. Les premiers à agiter les dagues lorsque le vieux lion faiblit." Pas vraiment adepte de la langue de bois, ce Bazin... On comprend aisément que ses envolées blogosphériques n'aient pas plu à tout le monde.
Segolène Royal en prend également pour son grade, ainsi que la "poignée de journalistes admiratifs (et -tives)" qu'elle a su "très habilement fidéliser autour d'elle", et qui ont offert, selon Bazin, le spectacle de remarquables "palinodies" (ou retournement de veste), dictées par le seul mouvement apparent du vent...
Et voici alors parti notre kamikaze de l'information dans une critique acérée de Nicolas Sarkozy et de Paris-Match, pointant du doigt le récent retournement de l'hebdomadaire, qui, un an après avoir froissé le Premier Flic de France en publiant une photo de sa femme au bras de son amant, nous offrait un numéro à sa gloire qui est resté dans toutes les mémoires, évoquant "un destin en marche". "Faut-il y voir le résultat d'un marchandage ? D'un changement de ligne éditoriale ? Une contrepartie ou une façon de s'excuser d'avoir été trop loin ?", s'interroge Bazin. "Une seule certitude : entre la Une sur Cécilia et la Une sur Nicolas, le directeur de la Rédaction de Match, Alain Genestar, a été remercié par son actionnaire. Nicolas Sarkozy a été tellement furieux de voir cette photo en couverture d'un journal du groupe Lagardère que pendant des semaines, il n'a plus pris au téléphone ni son propriétaire, Arnaud, ni Jean-Pierre Elkabach (patron d'Europe1, de Public Sénat et administrateur du groupe sus-nommé) dont il est si proche. Une brouille ostensible. Presque un début de guerre..." Et de dresser le portrait assez effrayant de "celui que le tout Paris considère comme "l'homme qui a une chance sur deux de devenir président de la République". Un homme à craindre et qui sait en imposer aux rédactions comme à ses collègues ministres." Sans oublier de taper sur les confrères, en dénonçant leur incorrigible lâcheté : "Et cette Une est sans doute un exemple frappant de cette pusillanimité qui reste le fort de certains journalistes et patrons de presse. Toujours avec les loups, gorge offerte. Les premiers à agiter les dagues lorsque le vieux lion faiblit." Pas vraiment adepte de la langue de bois, ce Bazin... On comprend aisément que ses envolées blogosphériques n'aient pas plu à tout le monde.
Segolène Royal en prend également pour son grade, ainsi que la "poignée de journalistes admiratifs (et -tives)" qu'elle a su "très habilement fidéliser autour d'elle", et qui ont offert, selon Bazin, le spectacle de remarquables "palinodies" (ou retournement de veste), dictées par le seul mouvement apparent du vent...
Bazin comprend ainsi fort bien le coup de gueule du candidat de l'UDF contre une certaine collusion politico-médiatique : "Je ne peux pas dire que Francois Bayrou se trompe lorsqu'il dénonce avec Jean-Francois Kahn la "bullocratie"." Mais, pour autant, il met en garde contre la tentation que l'on peut avoir, au regard de cette "bullocratie", de discréditer les journalistes : "Parce que je déteste autant qu'eux ces petits arrangements et que je n'ai pas le sentiment d'en être complice, je suis ulcéré de voir que ce thème des journalistes "loin de tout, pervertis par le système", est en train de devenir une autre forme de pensée unique." Protestation légitime, lorsque l'on n'est pas soi-même complice de ces petits arrangements entre amis. Il faudrait sans doute davantage de journalistes aussi peu complices pour que cette nouvelle pensée unique ne puisse prendre racine et se développer. Mais Bazin a jeté l'éponge hier matin. Blog fermé. Espace de liberté abandonné. Ce n'est pas là le signe le plus encourageant qu'il pouvait nous offrir, à nous, qui souhaiterions un quatrième pouvoir digne de ce nom. De quoi, à l'inverse, légitimer encore un peu plus le cinquième pouvoir, que j'évoquais hier à travers Thierry Crouzet.