Ce mardi soir, 22 août 2006, la chaîne TMC a rediffusé le diptyque autobiographique d'Henri Verneuille : Mayrig (qui signifie "maman" en arménien), suivi de 588, rue Paradis. Quel choc ! Quelle machine à faire chialer ! Pour aller vite, c'est l'histoire d'Azad Zakarian, né en 1915 pendant le génocide des Arméniens par les Turcs, émigré en 1921 à Marseille avec une partie de sa famille rescapée (son père, sa mère et deux tantes - les trois femmes formant ses "trois mamans"), et dont on va suivre tout le parcours, jusqu'à son triomphe d'auteur dramatique dans la haute société parisienne.
Azad Zakarian, adulte, est joué par Richard Berry, sa maman, Mayrig, par Claudia Cardinale, son père par Omar Sharif. Apparaissent aussi, dans de jolis seconds rôles, Jacques Villeret et Zabou.
Bien sûr, ce film remémore l'horreur du génocide arménien, narre la vie difficile de gens modestes venus de l'étranger, dit l'intolérance de certains Français, la bienveillance de certains autres, mais il met avant tout en évidence l'amour d'une famille, entièrement vouée au bonheur et à la réussite du petit dernier. Ces petites attentions, ces grandes inquiétudes, cette générosité qui ne compte pas sa peine, ce don de soi qui font l'amour.
Ce petit garçon qui se fait rejeter par ses camarades (racistes), et qui n'en dit mot à ses parents, qui leur raconte les plus beaux mensonges, pour ne pas les peiner, pour ne pas entamer leur joie, pour les conforter dans leur illusion que leur intégration est réussie. Et ces parents qui ne cessent de se "sacrifier", comme on dit maladroitement, pour leur enfant, qui, pour mieux dire, aiment d'un amour total l'objet suprême de leur amour : leur fils.
Ce qui pourrait apparaître comme un dégoulinage d'amour, c'est l'histoire souterraine et fondamentale de la plupart des familles du monde. Sous les oripeaux décevants de la vie, derrière toutes les activités, petites ou grandes, qui agitent le monde, que reste-t-il qui vaille vraiment, sinon l'infinie tendresse entre Azad et sa Mayrig, sinon l'attachement éternel d'un petit garçon devenu grand pour tous celles et ceux qui l'ont chéri, ses pourvoyeurs d'amour, d'amour pur comme l'impossible ?
Devenu grand, auteur talentueux de pièces de théâtre, riche et célèbre, marié à une femme qui gère sa carrière et son "look", Azad Zakarian aura travesti son nom, devenu "Pierre Zakar", à la consonance bien française. Lorsque son vieux père viendra le voir à Paris, pour la première de sa nouvelle pièce, "La chevalière", qui retrace précisément son enfance modeste et heureuse, Monsieur Zakar, conseillé par son épouse, le recevra dans une sublime suite d'un grand hôtel, mais pas chez lui. La chaleur humaine aura glacé sous les dorures. Peu de temps après, le père mourra, sans qu'un dernier malentendu avec le fils n'ait été levé. De quoi faire naître la culpabilité face à l'irréversible faute.
Le caractère de sa femme, créature monstrueuse, glacée et bassement intéréssée, se révèlera à Zakar de plus en plus au grand jour. Créature chez laquelle le mot "amour" semble avoir été vidé de toute sa substance. La séparation interviendra, au moment même où Azad se rapprochera de sa vieille mère, à laquelle il finira par offrir un magnifique cadeau. Dérisoire cependant. Dérisoire face à l'essentiel, face à la vie qui touche inéxorablement à sa fin, face à la détresse que le fils commence déjà furtivement à ressentir en songeant à cette Mayrig dont il ne sentira plus bientôt l'amour infini le recouvrir, avec ses petites attentions, ses petits soucis. (On songe vaguement à la chanson de Léo Ferré, "Avec le temps", même si le film n'est pas globalement aussi mélancolique et triste qu'elle.)
La dernière scène du film est assez déchirante : Azad quitte sa vieille mère aux cheveux blanchis, à laquelle il vient d'offrir une somptueuse demeure (588, rue Paradis à Marseille), ornée d'un majestueux jardin où fleurissent en pagaille des roses, comme dans sa maison "d'avant la France". Mayrig, s'apercevant qu'Azad a oublié son pull-over rouge, lui court après, l'appelle et lui rend son pull. Délicatesse anecdotique... Azad s'éloigne ensuite inéxorablement d'elle, que l'on continue de voir en arrière-plan, car elle le regarde s'éloigner, voulant profiter jusqu'au dernier moment de sa vue. Azad se demande alors combien de printemps il pourra encore venir la voir, il pense au jour où on lui téléphonera pour le presser de venir car sa mère n'ira "pas très bien". Et ce jour-là, il saura que plus jamais personne ne viendra lui apporter son pull-over rouge, pour le protéger d'un froid imaginaire. Ce jour-là, se dit-il, il aura vraiment froid. D'un froid glacial et éternel, dont on ne guérit pas.
Mayrig et 588, rue Paradis sont deux très beaux films, qu'avec du recul on peut certes considérer comme un peu simplistes, manquant de finesse d'analyse, quelque peu manichéens. On peut aisément le comprendre pour le premier film, qui est le regard d'un adulte sur son enfance et les personnages qui l'ont constituée. C'est un peu moins compréhensible pour le second, qui est le regard d'un adulte sur sa propre vie d'adulte. Mais l'essentiel n'est sans doute pas là. Il est dans la simplicité et la force du contenu émotionnel de ces deux films. Dans l'évidence devant laquelle ils nous mettent : la valeur absolue de l'amour pour nous humains, la terrible fragilité de la vie, la noblesse de caractère qui se reconnaît à l'honnêteté et à la qualité d'amour dont nous sommes capables. Ce n'est pas du "bon sentiment" ; c'est de la vérité à l'état brut.
Léo Ferré - Avec le temps
Vidéo envoyée par sasoeursophie22

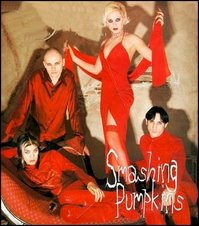



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire